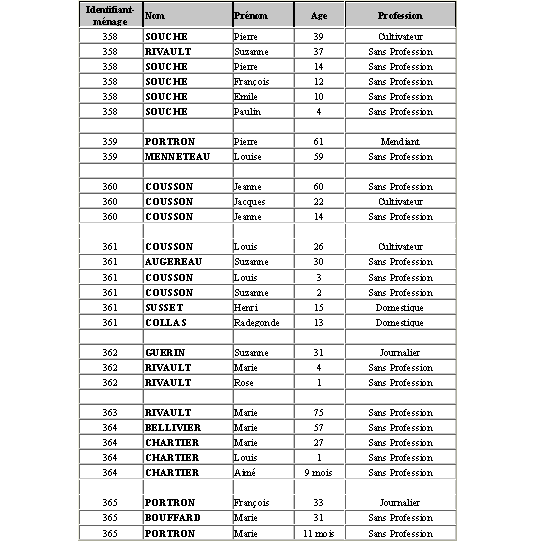
SOMMAIRE du Numéro 18 :
Réfugiée à St-Sauvant en 1940 : Les souvenirs de la petite Lorraine
Cuniculture ou cuniculiculture : Une bien belle vie
Rencontre avec P. et D. Demarbre : Un déménaghement de la Sint-Michâ
Villages d'hier et d'aujourd'hui : Le Bois de Sairé
Outils d'autrefois : Un maçon des années 50
Mots croisés : La grille à Suzanne
Parcours de guerre : Noré, un poilu parmi tant d'autres
Réfugiée à Saint-Sauvant en 1940
LES SOUVENIRS D'UNE PETITE LORRAINE
Monique GRZESIAK
Elle se nommait alors Monique Michel et avait 10 ans. Elle fut réfugiée
avec ses parents, Alexandre Michel et Eugénie, née Stouvenacker, et sa soeur
Geneviève, 14 ans, à Saint-Sauvant, de décembre 1940 à mai ou juin 1941.
Soixante-huit ans plus tard, elle a voulu rendre hommage à deux personnes qui
l'avaient accueillie avec les siens à Saint-Sauvant : le maire Gustave
Bruneteau et le curé l'abbé Bordage. Le 9 septembre dernier, Mme Grzesiak est
venue passer la journée à Saint-Sauvant. Elle s'est recueillie sur les tombes
de ce maire et de ce curé. Elle a voulu revoir la maison de l'ancien maire,
l'ancien presbytère et retrouver une amie, Ginette Dancre, devenue Mme Paineau.
Nous lui avons demandé de nous raconter ses souvenirs de petite Lorraine réfugiée
à Saint-Sauvant. Nous l'en remercions.
Quand la famille Michel est arrivée à Saint-Sauvant, elle faisait partie d'un
convoi de 244 réfugiés appelés ici " les réfugiés de la Gironde
", parmi lesquels 135 juifs qui furent déportés par la suite, et dont la
plupart ne sont pas revenus 1.
De la Moselle à la Gironde
Nous habitions Longwy à la déclaration de la guerre, le 3 septembre 1939.
Dès le dimanche suivant, journée très ensoleillée, dans l'après midi, des
employés de la mairie sont passés dans toutes les maisons avec un ordre d'évacuation
pour les femmes et les enfants, ordre formel de départ pour le lundi matin 8
heures, vers une région moins vulnérable que la nôtre mais sans précision.
Les hommes étaient requis civils et devaient rester à leur poste. Mon père
travaillait à l'usine de la Chiers.
Départ du train très grand et complet lundi vers 9 heures. Arrivée mardi 18
heures à Saint-Germain d'Esteuil (Gironde). Nous avons couché à une
cinquantaine dans une grange, sur la paille. Par la suite, Maman, ma soeur et
moi avons été logées à l'école du village.
Le temps des vendanges arrivant, Maman et ma soeur ont participé à ces
vendanges et, le 1er octobre, j'ai fait la rentrée à l'école. Nous avons déménagé
à Lesparre, puis à Soulac-sur-Mer.
Le 10 mai 1940, l'évacuation générale de Longwy était décrétée, les
Allemands, ne respectant pas la neutralité de la Belgique, l'envahissaient et
arrivaient à Longwy. Les employés de l'usine de la Chiers se sont repliés sur
Paris, siège social de l'usine, et ont oeuvré quelques semaines à l'usine de
Saint-Denis. Puis ce fut la débâcle, les Français fuyaient au fur et à
mesure de l'avancée allemande. Nous sommes restées sans nouvelles de mon père
et l'avons cru décédé ; les attaques aériennes qui mitraillaient ces longues
files humaines étaient courantes.
Fin juillet, mon père est arrivé un soir vers 23 heures, amaigri, méconnaissable,
épuisé, " heureux ".
Les réfugiés vivaient très mal la présence de l'occupant à Soulac et se
disaient : " Pourquoi avoir quité Longwy pour voir ces soldats prétentieux
et arrogants se pavaner sur la plage ? " Les adultes avaient le souvenir
vivace de 1914-1918 alors que les régions du sud n'avaient pas connu
l'occupation de la première guerre.
Et puis, une jour d'hiver 1940, alors que nous étions à table pour le repas de
midi, deux soldats allemands sont arrivés accompagnés d'un chien berger et
nous ont remis un ordre de départ, sans autre explication, pour l'après-midi
16 heures. Un train a été formé (sous contrôle militaire allemand) de Juifs,
Gitans et autres, toujours destination inconnue.
Le 3 décembre 1940 à Saint-Sauvant
C'est en pleine nuit que nous sommes arrivés à Rouillé, le 3 décembre.
En fin de nuit, les Allemands, accompagnés de chiens bergers, nous ont regroupés
dans une cour. Le froid était intense. Ils ont commencé par séparer les
hommes des femmes et des enfants, puis un gradé est venu donner l'ordre de ne
pas séparer les familles. " Merci mon Dieu ", murmurait maman qui
comprenait l'allemand. L'appel terminé, des tombereaux nous ont chargés. Le
sol était gelé, le jour pointait et les champs, blancs de givre, étaient
envahis de corbeaux ; c'était lugubre. Le parcours nous a paru très long, car
nous ne savions pas où nous allions. Enfin, nous sommes arrivés sur la place
d'un petit village et ce village était Saint-Sauvant.
En ce qui me concerne, je n'ai souvenir que de deux personnes sur cette place :
un prêtre et, à ses côtés, un petit monsieur à lunettes qui paraissait
bienveillant et rassurant : l'abbé Bordage et M. Bruneteau. Me tenant par la
main, ma soeur s'est approchée du prêtre et lui a demandé une image sainte.
Il a apposé sa main sur la tête de ma soeur et a dit : " Je te promets,
tu l'auras ". Et il lui a caressé la joue. Bizarrement, froid et peur qui
m'habitaient se sont éloignés.
Nous sommes arrivés dans une grange. Une échelle assez résistante menait à
un grenier sans fenêtre, une simple lucarne laissait filtrer la lumière du
jour, où se trouvaient une table, quelques chaises, des étagères avec
quelques casseroles, assiettes, bols et couverts. Pas d'eau. Dans une pièce, à
côté, deux lits de deux personnes, un pour mes parents, l'autre pour ma soeur
et moi. Par bonheur, cette pièce était dotée d'une fenêtre nous permettant
de voir une grande étendue de prairie, et, perdue dans la verdure, une petite
tombe. Par la suite, Mme Bruneteau nous a appris que sa fille était enterrée là.
Sa grande tristesse nous peinait énormément.
Cette rapide visite terminée, nous avons rejoint le groupe, et, encadrés par
les Allemands, sommes allés dans une grande salle ou grange, où un bon potage
nous a été servi et des haricots blancs. Les dames qui nous servaient étaient
très gentilles et nous rassuraient par leur sourire.
Vers la fin du repas, M. le curé est revenu et nous a invité à le suivre pour
nous remettre l'image sainte promise le matin. Voilà comment nous sommes entrés
à la cure pour la première fois. Là, se trouvait la soeur de M. le curé,
dame fortement handicapée. Mlle Cécile a servi un café à mes parents.
Lorsque nous nous sommes retirés, elle nous a fait promettre de venir la voir
le plus souvent possible. Pour ma soeur et moi, c'était le bonheur. Maman
souriait et papa, silencieux, était très ému.
Nous sommes allés prendre possession de notre nouvelle demeure, sans électricité
; une simple lampe à pétrole. Ma soeur et moi faisions la moue, disant :
" C'est sombre ". Maman tentait de nous persuader que c'était
merveilleux, intime et beaucoup plus chaleureux. Au bout de trois jours, nous étions
de son avis : c'était le Paradis.
Chaque matin, appel par les Allemands
Chaque matin nous remettait face à la réalité : appel par les Allemands et départ
pour les hommes vers la forêt pour débroussailler et exécuter divers
travaux.
Rapidement ,je suis allée en classe, école catholique dirigée par Mlle Mélanie.
Toutes les dames qui enseignaient étaient des religieuses vêtues de noir mais
en tenue de ville. Je crois que les Allemands exigeaient celà. Dès que je suis
arrivée, plus que mon niveau scolaire, ce qui l'intéressait était de savoir
si je savais mes prières et faire mon signe de croix. Satisfaite, j'ai été
chargée d'apprendre au plus vite prières et signe de croix à deux petites
filles du groupe de déportés, deux petites filles Juives, car, inopinément,
les Allemands arrivaient et désignaient du doigt : " Toi, toi et toi
", et l'enfant devait réciter prières et faire signe de croix. Donc il était
impératif que ces petites filles répondent aux critères exigés. Je pense que
c'était une protection pour elles.
Petit à petit une vie normale s'organisait. Dès le matin, appel des Allemands
devant la mairie, visite à la cure, bol de lait, école. Dès que les repas
servis à l'ensemble des réfugiés se sont arrêtés, nous avons pris nos repas
à la cure où Maman aidait Mlle Cécile dans ses travaux ménagers. Lorsque
Papa rentrait le soir, il effectuait divers travaux pour M. le curé. L'atmosphère
de la cure était agréable, reposante et protectrice. La petite fille que j'étais
était gâtée et heureuse.
Comme ma famille, se trouvaient à la cure une Irlandaise, Miss Gréta
Geoghegan, et une Juive, Mme Zoë Guldenberg, deux personnes tellement différentes
mais si attachantes. Mme Guldenberg était, pour ma soeur et pour moi, la grand'
mère dont nous étions sans nouvelles depuis le début des hostilités.
En plus, j'avais la chance d'avoir trouvé une amie, fille du village, Ginette
Dancre. Dès que je le pouvais, j'allais au fond du jardin et " encore
" par une échelle j'accédais à la ferme où, avec la permission de Mme
Dancre, je pouvais ramasser les oeufs et, plaisir suprême, voir les poussins naître.
De son côté, ma soeur s'était liée avec Ida Brunet, fille cadette de la
famille qui comprenait de nombreux membres tous très accueillants.
Là, j'ai assisté à la naissance de petits porcelets ; ils étaient adorables
et, comme pour nous tout était nouveau, c'était excitant. Cela se passait à
la Contentinière. Je m'égare dans des détails, mais ce sont ces moments qui
adoucissaient les nombreux moments d'inquiétude.
Noël dans notre grenier
Nous approchions de Noël, lorsqu'un monsieur seul, très distingué,
faisant partie du groupe des réfugiés, s'est approché de mes parents et leur
a demandé de bien vouloir l'écouter. C'était M. Roscam. Si j'ai bonne mémoire,
il était avocat ou dans la magistrature. Ma soeur et moi avons été invitées
à nous retirer. Mes parents et ce monsieur ont parlé longuement. Lorsqu'il est
parti, mes parents nous ont annoncé que nous allions faire Noël chez nous. Il
faut que je dise que, malgré mes dix ans, je croyais encore au Père Noël.
Maman nous a dit que, malgré les difficultés que le Père Noël allait
rencontrer pour retrouver les petits enfants dispersés, il y avait une chance
" peut-être " d'avoir un petit cadeau !
Le 24 décembre arrive. L'après-midi, maman dresse la table, un drap de lit
blanc en guise de nappe, et met sept couverts disparates, la lampe à pétrole
au centre de la table. Ma soeur et moi ne comprenions pas puisque notre famille
était composée de quatre personnes. Donc attente curieuse.
Dès la nuit tombée, papa était aux aguets, surveillait, nous ne savions pas
quoi. Soudain M. Roscam est arrivé accompagné de sa femme, venue de Bordeaux
à l'insu des Allemands car elle n'avait pas été déportée et ce qu'elle
allait faire était très risqué pour sa vie. M. Bruneteau était au courant et
aidait. Donc, à ce repas, ce couple, plus Mme Guldenberg. Menu : chou rouge,
marrons, dinde et fruits, pommes, poires.
Dès le repas terminé, M. et Mme Roscam ont pris congé après un guet pointu
de mon père. Ils nous ont embrassés en disant à mes parents : " Nous
n'oublierons jamais ". Et nous ne les avons jamais revus. Mme Roscam avait
certainement pris des dispositions pour une évasion de son mari.
Pour Noël, j'ai reçu une jolie poupée en celluloïd de 25 cm qui, avec
l'accord de la soeur de M. le curé, se prénomme Cécile. Elle est toujours en
parfait état et m'a accompagnée en Afrique noire lors de notre séjour de
travail.
Le 25, nous étions chez M. le curé, avons assisté à tous les offices car, à
cette époque, dimanches et jours de fêtes ils y avait quatre offices : le
matin très tôt, 10 h., 14 h., 17 h.
La vie a repris son cours normal. Le 13 février 1941, j'ai fait ma communion
privée (anecdote : mon fils est né le 13 février 1951, juste dix ans après).
Nous avons fait Pâques à Saint-Sauvant.
Un faux départ pour Longwy
Quelques semaines après, mon père a reçu un ordre de rappel de la société
qui l'employait. Donc, quelques jours plus tard, heureux d'un côté et tristes
de l'autre, nous voilà partis pour Poitiers pour un retour vers notre région.
Mais là, peur et crainte car les Allemands, qui contrôlaient chaque départ de
train, ont commencé à crier et se sont opposés à notre départ, et retour
manu militari sur Rouillé puis, de nouveau sur tombereau, pour Saint-Sauvant.
Ce qui a été émouvant et réconfortant, c'est l'accueil chaleureux, tant chez
M. et Mme Bruneteau qu'à la cure et des amis du village.
La vie a repris son cours. Papa a dû contacter son employeur qui, lui, était
sommé de remettre son usine en marche, la production d'acier étant impérative
pour l'occupant.
Le plus dur restait à venir
Quelques semaines après, à la suite de l'intervention de la direction de
l'usine, des papiers en bonne et due forme sont arrivés. De nouveau Poitiers
et, là, un train venant de Gironde et formé uniquement d'employés et
d'ouvriers du bassin de Longwy nous a permis de rentrer. Jusqu'au départ du
train, notre crainte était grande d'être obligés de rester. Ce que nous ne
savions pas, c'est que le plus dur restait à venir.
Après notre retour en Lorraine, la vie a été très dure : faim et alertes de
nuit qui nous obligeaient à nous abriter dans une mine de fer où nous
pataugions dans l'eau des heures durant.
Je pense qu'avoir vécu ces moments nous a permis d'être plus forts pour
affronter les aléas de la vie.
Ce que je retiens de ces années : une grande admiration pour mes parents qui,
dans l'anonymat le plus complet, ont pris de grands risques par humanité et
patriotisme, et une reconnaissance infinie à l'armée américaine, car Longwy
étant sur la route de Bastogne (Belgique), pendant plus d'un mois, en matinée,
des convois de jeunes soldats partaient au front en chantant et, le soir et à
la nuit tombée, autant de convois de jeunes soldats décédés et corps gelés
- car l'hiver 1944-1945 fut très dur - reprenaient la route en sens inverse.
Que pouvions-nous faire, sinon prier ?
Voilà, je vous rapporte fidèlement ce que ma mémoire d'enfant a enregistré.
Cuniculture ou cuniculiculture ?
Ou bien les deux ?
UNE BIEN BELLE VIE
Suzanne POINSTEAU
Le vieux mâle à Léontine, “ le veut bé core, mais le veut pu rin ”.
Qu’est-ce à dire ? Le veut ou le veut pas ? Faudrait savoir !
Traduction : le vieux mâle de Léontine, il veut bien encore (du verbe vouloir) mais il ne vaut plus rien (du verbe valoir).
Et oui, malheureusement ce sont des choses qui arrivent ...!
Mise au point : afin de lever toute ambiguïté, précisons tout d’abord que le vieux mâle de Léontine c’est son père lapin.
Ne nous égarons pas : il faut savoir raison garder quand même !
Or donc, ce vieux père lapin - Jeannot pour les intimes - se livrait encore avec ardeur au simulacre de la pérennisation de l’espèce, mais il n’était plus hélas l’étalon fringant de sa jeunesse.
On affirme qu’il avait été en son temps le plus prolifique et le plus bel albinos qu’on ait jamais vu.
“ A l’insu de son plein gré ” comme dirait l’autre, il fut déclaré en cessation d’activité, puis couronné “ Reproducteur Emérite ”, et enfin élevé à la dignité de l’honorariat pour l’excellence de ses performances.
(*)Voilà donc un gaillard qui, avec un coub’ de livres (2 livres soit 1kg) de lard gras et un bon verre de goutte (eau-de-vie), va sans plus tarder se métamorphoser en une pâtissière de lapin réservée aux vieillards maniaques d’une maison de retraite “ grand standing ”, ou bien trôner sur la table prestigieuse d’un restaurant étoilé sous l’appellation “ Terrine de lapin au vieil Armagnac ”.(*)
Bravo mon vieux Jeannot ! Quel fabuleux destin !
De surcroît, ta fin glorieuse nous a tous bluffés.
Tes descendants seront fiers de toi.
Ciao l’artiste !
Léger mal ... entendu
Eh bien, telle que vous me voyez, me voilà dépitée (non : c’est “ pour de faux ”, le mot dépasse de loin ma pensée) tout juste un peu déçue parce qu’en lisant la partie de mon texte comprise entre les deux astérisques (*) je fais le pari que vous n’avez pas souri. J’avais pourtant, pour atteindre mon but, misé sur l’homophonie.
Sur un panel d’une petite dizaine de personnes à qui j’ai fait lire ces quelques lignes, seulement deux ont remarqué ce que je désirais que l’on remarquât !
J’en déduis donc en toute logique et surtout en toute humilité que la faute m’en revient. Je vais donc réitérer mon expérience “ en acachant mé ”, en appuyant davantage.
Et puisque l’homophonie, comme son nom l’indique joue sur les sons, lisez donc ces quelques lignes à haute voix :
“ Si un vieillard maniaque
aime siffler (boire) un vieil Armagnac
c’est parce que ce vieil Armagnac
aime se faire siffler par un vieillard maniaque ”
CQFD
Où il est avéré que : “ Personne n’est irremplaçable ma Bonne Dame ”
Le clapier de “ feu Jeannot ” resta inoccupé pendant une bonne quinzaine de jours. Par décence et en souvenir de son Albinos bien aimé, Léontine ne voulait pas acquérir un nouveau reproducteur avant que sa dernière larme fût séchée et sa dernière bouchée de pâté avalée ... et digérée.
Dès que l’un et l’autre de ces préalables furent réglés, elle enfourcha prestement sa bicyclette et se rendit au village voisin afin de s’approprier “ le Nouveau ”.
Il s’agissait d’un jeune reproducteur stagiaire répondant au nom de “ Cuniculi ”. Son poil brillant d’un gris-argent témoignait d’une santé insolente. Son port de tête lui conférait un air faraud du fait que l’une de ses oreilles était constamment cassée tandis que l’autre toujours très droite arborait un tatouage lui tenant lieu de carte d’identité et de passeport.
Obligation lui avait été notifiée de passer sous les fourches caudines de l’hygiène vétérinaire réputée pour son exigence drastique surtout en période d’épidémie et a fortiori de pandémie.
Le C.D.S. (Conseil des Doctes Savants) attesta qu’il n’était pas porteur du virus H1N1. C’est ainsi que l’éphèbe argenté se présenta crânement sans masque et quasiment au garde-à-vous.
Ah ! “ ça l’faisait ” comme disent les d’jeun’s ...
Cuniculi fut ému de l’accueil qu’on lui avait réservé. Il trouva sa garçonnière tout à fait à son goût : Léontine lui avait préparé une litière douce et odorante qu’il apprécia avec délectation.
Il fut embauché en C.D.D. (Contrat à durée déterminée) pour six mois. Le contrat stipulait qu’il devait engendrer une moyenne de neuf lapereaux par portée sous peine de peine d’être transformé en salmis (vous connaissez certainement tous ce délicieux ragoût composé de morceaux de viande doucement mitonnés dans une sauce au vin). C’est la raison pour laquelle il s’acquitta scrupuleusement et avec coeur de sa mission. Sans surprise il fut rapidement titularisé dans sa fonction.
Un jour, il sussura à l’orielle de Léontine, comme le font certains acteurs de cinéma quand à la télé ils sont interviewés au sujet de leur art : “ Madame ce n’est pas du travail, ce n’est que du plaisir ” et il en clapissait de bonheur, le coquin !
Chers lecteurs, je vous demande de bien vouloir m’excuser mais je ne puis m’appesantir davantage sur les tribulations de Cuniculi, ce serait trop long et vous en seriez lassés, autrement dit “ o vous vasserait ”.
Sachez seulement que ses rencontres avec la gent féminine ont été rarement laborieuses, parfois surprenantes, mais toujours productives.
Gageons qu’à l’instar de son prédécesseur, Cuniculi aura une belle vie et pourquoi pas une vie hors du commun. C’est en tout cas ce que nous lui souhaitons.
Dernière nouvelle
On chuchote, autrement dit “ o se marmuse ” que Cuniculi serait sur le point de figurer dans le Who’s Who (répertoire des personnalités). Celui de nos amis les bêtes bien entendu !
Rencontre avec Paul et Denise DEMARBRE (*)
- « Notre déménagement à Anne Marie ? »
- « C’était le troisième que nous avions fait. Mais ce fut le plus important et le plus loin. Après la Chevraise, nous étions installés depuis cinq ans à la Teillée dans la maison de madame Sire, et Hélène n’y était pas heureuse. »
- « Et pourquoi Madame Sire n’est elle pas restée dans sa maison ? » répétait-elle souvent.
- « Nous avions besoin d’espace de culture et la ferme d’Anne-Marie venait d’être libérée à la retraite de la famille Roy. C’était une grosse ferme et nous avons trouvé la maison grande en y arrivant. Il nous aurait fallu une bicyclette pour aller dans ces immenses pièces, nous, on n’y était pas habitués ! Mais comme les champs étaient proches de la ferme, on a pu y travailler. »
Sûr qu’ils ont bossé, les Demarbre à Anne-Marie !
Mais comment sont ils venus de la Teillée en 1958 ?
- « Eh bien, on a tout mis dans les mues, maman est venue nous aider à envelopper la vaisselle dans des journaux, dans des paniers, des cartons …
Maurice Marcheteau avait pris une journée à la laiterie pour nous aider avec son camion.
Et, en passant par les raccourcis, les bêtes (vaches) sont venues à pieds, après la traite. Les chiens les guidaient en passant des Merzelières au Courtiou pour arriver à Anne Marie. Les chèvres avaient suivi comme si elles allaient aux champs.
Nous avions décidé de ne pas emmener « Montagne » notre plus vieille chienne pour ne pas la fatiguer, nous l’avions confiée aux voisins, mais c’était sans compter le chagrin de la pauvre bête qui nous a rejoints à Anne-Marie dès le lendemain.
Par contre, fallait pas déménager les chats, ça portait malheur …
Alors, on avait laissé le chat, et lui est resté à la Teillée.
Les poules ont été mises dans des paniers dès la veille comme les lapins. Frappier nous avait aidé avec sa mue, il emmenait les gorets. Seuls les meubles sont partis en camion. Fallait tout démonter, protéger, et en plus il pleuvait !
Les lessiveuses, les échelles, les fourneaux, c’en était un « brassement » !
Et l’on imagine qu’arrivés à Anne-Marie, il a bien fallu quelques jours pour que tout retrouve une place et que chacun prenne ses marques.
Le travail n’allait pas manquer, il fallait s’installer rapidement et se mettre à préparer les labours et les couvrailles.
Le bail, pour neuf années, allait prélever une part de la récolte pour le propriétaire : 359 quintaux de blé, mille kilo de viande et 3500 litres de lait payables en deux échéances : les 25 mars et 29 septembre de chaque année. »
- « Hélène avait dix ans.
Fallait changer les habitudes de cette maison enfin adoptée et quitter l’école de Pouzeau et les copines …
C’était pas rien ! A la veille de rentrer à l’école !
A la Forêt, Hélène trouvait sa solitude bien lourde quand les autres se retrouvaient entre copines après les vacances de l’été. Enfin, elle a réussi à s’accoutumer, Martine et Annie, Sylvie, Maryse surent l’accueillir et les autres élèves aussi bien sûr ... »
La famille Demarbre parle encore avec une certaine nostalgie de ces quinze années de leur vie active …, de leur jeunesse.
Ils y seraient bien restés si la fatigue et l’âge ne les avaient pas alertés. C’est ainsi que la terre les a attachés à la commune de Saint Sauvant.
(*) Au moment de publier cette rencontre, Paul nous a quitté, Denise reste près de sa fille Hélène et de sa famille. Au delà de l’absence, cet article permet de les réunir pour évoquer leurs souvenirs. L'équipe de la Boulite les embrasse et les remercie encore d'avoir partagé avec eux ces chaleureux moments.
Villages d’hier et d’aujourd’hui
LE BOIS DE SAIRÉ
Jean-Roger AUGUSTIN
Le village du “Bois de Sairé” que nous étudions dans ce numéro fait parti d’un groupe de trois villages, autrefois appelé “Les Sairés” composé par le “Petit Sairé”, le “Grand Sairé” et le “Bois de Sairé”. Un prochain article de la même série “Villages d’hier et d’aujourd’hui”, sera naturellement consacré au Petit et au Grand Sairé.
Dans son livre “Les noms de terroirs”(1), Guy Puaud répertorie neuf villages ou fermes de Saint-Sauvant “dont l’origine lointaine peut remonter jusqu’à l’époque gallo-romaine (1er au 5ème sicècle)”. Il s’agit de : Chiré, Courgé, Donné, Luché, Nillé, Savigné, Vernay, Vitré et Sairé.
On distingue deux origines possibles pour ces noms gallo-romains : - le nom du propriétaire de la villa gallo-romaine implantée au centre d’un domaine rural, ainsi Chiré serait le domaine de Carius, Victorius pour Vitré, Donnos pour Donné
- le nom peut “aussi évoquer la végétation, la nature du sol ou le relief”, ainsi Nillé (anciennement Neillé) un lieu humide, une cuvette retenant l’eau ou encore Vernay (vernos en gaulois) pour un lieu boisé d’aulnes, aussi appelés vergnes.
Pour Sairé on hésite, les deux origines sont possibles. Soit une villa gallo-romaine appartenant à un certain Serius, soit la référence à très léger relief (serra), un dos d’âne.
Ce nom a connu de nombreuses variations au cours des siècles :
1486 : Sayré 1681 : Seiré, Seré ou Serré
1685 : Cesré 1686 : Sairé
1710 : Les Sairés 1712 : Les Sayrés
1730 : Seray 1781 : Sesré
1792 : Sairé 1836 : Le Bois de Céré
1934 : Le Bois de Sairé
1 Guy Puaud, Les noms de Terroirs ou la Mémoire des Lieux, 1992, Hérault Editions, page 40.
Le recensement de 1846
En 1846, le village comptait 25 foyers, pour une population totale de 80 habitants.
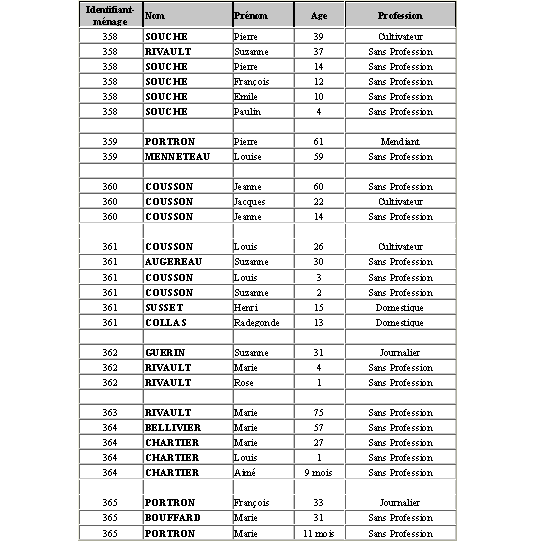
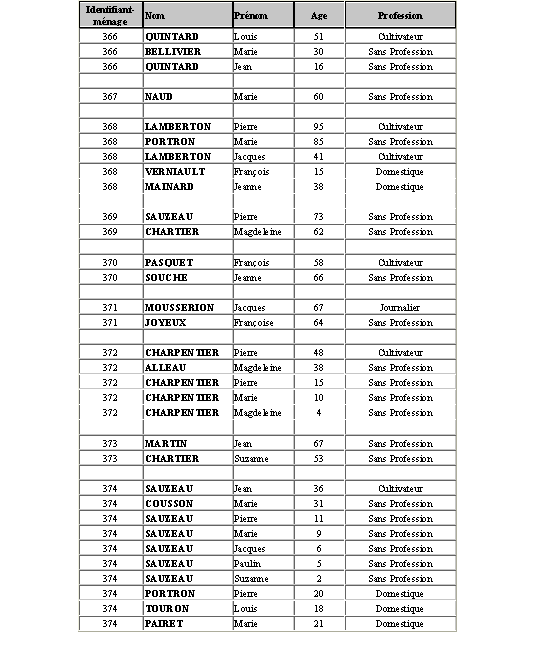
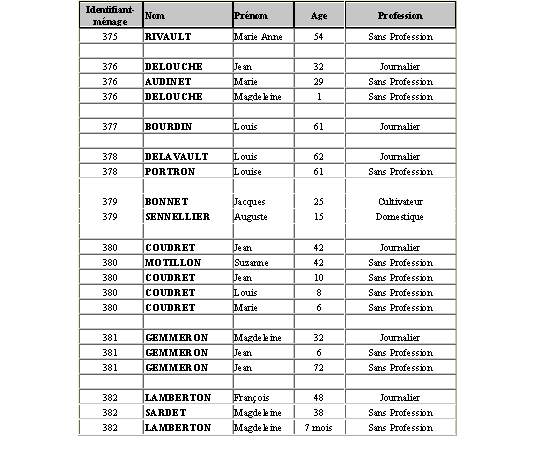
Le recensement de 1954
En 1954, le village comptait encore 13 foyers, pour une population totale de 41 habitants.
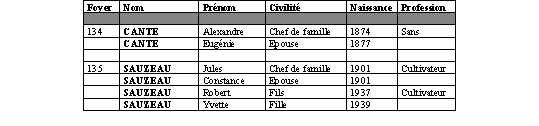
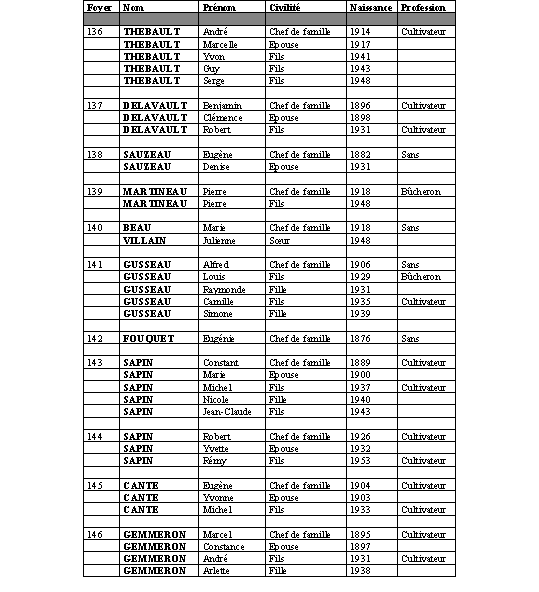
De nos jours, le village du Bois de Sairé est composé de 10 foyers pour un total de 26 habitants permanents. Parmi ces dix maisons, deux sont des gites ruraux loués à l’année. On notera la présence d’une famille d’origine anglaise installée à demeure dans ce village.
Outils d’autrefois
UN MAÇON DES ANNÉES 50
Jacqueline CZERWINSKI
A la manière du poète Lamartine, Michel Bussereau pourrait prononcer ces vers venus d’un autre temps : « Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? Qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ? »
Car il les aime, ses outils. Fils d’Alphonse Bussereau, maçon de son état, il a fait son apprentissage avec son père dès l’âge de 14 ans. De lui, il a appris les techniques du métier et les vraies valeurs de la vie qui construisent un homme. Fidèle à son clocher, il a continué l’œuvre de son père et n’a pas quitté son village natal de Bois-le Bon où il passe maintenant une retraite paisible avec Thérèse et ses enfants, petits et grands.
Des outils d’un autre temps
Passionné par son métier de maçon, Michel en a gardé les outils de l’époque et c’est avec des étincelles de fierté dans les yeux qu’il a bien voulu en dévoiler les secrets pour la Boulite. Intarissable dans ses propos, il raconte, dans un patois « ben d’chez nous », les différentes étapes de la construction et les souvenirs parfois cocasses s’y rapportant. Pas de compresseur, pas de bétonnière, pas d’électronique, encore moins d’informatique mais les outils de son père soigneusement remisés et répertoriés dans son atelier.
Préparation du mortier
Avant l’arrivée du maçon, le paysan qui voulait faire construire ou réparer un mur allait chercher de la terre grasse dans les champs. Il la vidait sur le lieu du chantier et le maçon y ajoutait de la chaux vive. Avec une « piarde », il mélangeait le tout et mouillait le tas au fur et à mesure, jusqu’à ce que la chaux « meure ». Le lendemain, il fallait encore brasser l’ensemble avec un « bouloir » et surtout ne pas voir de « merde d’ageasse », c’est-à-dire des traces visibles de chaux dans le mortier. Quand ce dernier était prêt, on pouvait commencer à maçonner.
« L’osiâ »
Michel n’a jamais su le vrai nom de ce drôle d’engin qu’il a toujours appelé « l’oiseau », « l’osiâ » en patois.
Quand la maçonnerie commençait, les premières pierres étaient faciles à poser et le mortier était transporté à la brouette. Mais, quand le mur prenait de la hauteur, il fallait monter un échafaudage tenu par des cordes prises chez Maringues, le cordonnier du bourg, et dont les « crûs d’chafâ », trous laissés dans la maçonnerie après la dépose d’un boulin, en sont le témoignage.
Quant au mortier, plus question de le transporter à la brouette ! Alors, « l’osiâ » entrait en piste. Une sorte de hotte ouverte, en bois, mobile, montée sur un
trépied à hauteur d’homme, que le maçon portait sur son dos et sur laquelle on déposait pas moins de 40 kg de mortier ! Pas toujours facile de grimper à l’échafaudage avec un tel chargement ! Et Michel entend encore la voix de son père qui lui disait : « Drôle ! la colle ! Amène la base ! » quand il fallait aller au ravitaillement de mortier.
La taille des pierres
En même temps que la maçonnerie, il fallait tailler les pierres et les enjoliver. Pour cela, il existait toute une panoplie d’outils que Michel a soigneusement conservés. Des taillons pour les coins, des bouchardes pour taper sur la pierre et enlever les bosses, des piges pour la piquer, des pilons pour tasser la pierre sur le mortier, des dames, des battes pour tasser et niveler le mortier, des équerres, des compas, des marteaux, un fil à plomb pour la verticalité du mur, des pointerolle, des ciseaux et des gagne-pain pour faire les joints.
Un moulin à crépir complétait la panoplie du parfait maçon des années cinquante !
L’amour du travail bien fait
Encore fallait-il savoir se servir de tous ces outils avec dextérité. Les gestes effectués devaient être précis et appropriés. Penser avec ses mains était indispensable et l’outil devenait alors le prolongement de la pensée créative de celui qui, pour le temps de l’ouvrage, devenait un artiste.
Aujourd’hui, ces outils ne servent plus mais ils restent, pour Michel, les témoins de son travail, de sa passion et de tant de souvenirs qu’il prend plaisir à raconter.
Mots croisés
LA GRILLE A SUZANNE
Suzanne POINSTEAU
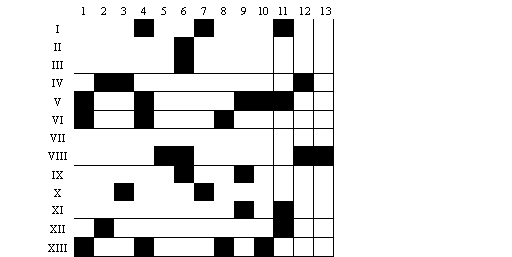
De gâche à drète
I – « Appellation d’origine contrôlée ». – Couète d’hirondelle. – Piaça. – La moitié de la bourgeoise à tonton. II – Le petit nin de la mariaïe à Malraux, tchau qu’avait si bin déclamé au Panthéon : “Entre ici Jean Moulin ! ...”. – Crus d’nas. III – Un endret voure qu’ol a que daus femmes peure un seul gars : creyez-vous pas vous âtres ?… – Comme daus croûtes de tartes crues qu’ariont passé sous le rouleau à pâtisserie, ou bé daus confitures su une gressaïe. IV – Biâ métier d’une femme ou d’un homme qui travaille le bois peure en faire daus meubles ou putout daus œuvres d’art. V – Symbole dau plomb. – O sert à fixer les teintures en particulier su les tissus. – Sigle d’un parti politique. VI – La note qui met tout le minde d’accord dans les orchestres. – Shampoing employé dépeu déjà longtemps (publicité). – Le nin de famille de Louis XVI. VII – Rimâle. VIII – Nin poêtique de l’Irlande. – Li et pi Moïse (tchau qu’avait été sauvé des eaux), eh bé, l’aviont le même père et la même mère. IX – L’étiont sept avec Blanche Neige, ce qui fait que l’étiont huit en tout à vive sous le même tet.– Initiales de tchelle
si belle actrice qu’a joué avec Philippe Noiret dans « Le vieux fusil », entre autres. – Quinte on arrive à tchau panneau, o faut absolument s’arrêter, qu’on seye à chouâ, en auto, à bicyclette ou même de ses pés. X – Initiales religieuses catholiques. – Onomatopée qu’on dit comme peure s’encourager à se lever, peure sa ou peure les âtres. – Chavan ou bascouète, ou sanzeille, ou roibeurtâ, ou chaveuche, ou prâsse, ou feurzoi et pi la liste est lin d’être finie … XI – Fameux fleuve de Russie. – Tellement. XII – Soûleras, étourdiras avec daus paroles, dau vin, daus danses … ou d’âtres produits (illicites que l’seriont). – Tout juste la mouétché d’une maisin de paysans russes faite avec daus rondins de bois de sapin. XIII – Mesure étrangère de 576 mètres en Chine principalement. – Le peut être de saisin, ou mouillassous, ou pourri, ou indien, ol est selon. – Dramé, qu’a b’sin d’être rempiacé.
De hât en bas
1 – Une espèce de céléri ou bé étou l’homonyme de « cougnaïe ». – Rechaner. 2 – Ol est ce que fasont les spectateurs quinte le sont bin contents daus artistes le se levont et le se rassitont lentement avec les bras qui seuguont les mouvements : o fait de bin jolies vagues. – Pien de minde, tout un soula ... 3 – Autobus. – La j’ment a rechané, la vache a bramé, le bourricot a ricandé et l’éléphant li ? – « Gin » mal brassé dans sa bouteille. 4 – Le chin jape, le p’tit chin jhioule, la cheuvre brèle et le chevreuil li ? – Grous chail qui se tint tout debout et daus foués avec d’âtres o forme daus alignements comme à Carnac. 5 – Danse d’été à la mode o y a une dizaine d’annaïes : les danseurs se teniont bin sarrés d’une facin coquine. – Comme un clône, mais pas un clône quand même. 6 – Tchau dau nord comme tchau dau sud : lu à l’envers. – Onomatopée peure appeler discrètement (ou du moins on o crè, mais ol est pas tejou le cas) 7 – Nymphéa comme tchés qu’a peints Monet dans son biâ jardin de Giverny (nom au singulier). – « Tripiaïes bianches » comme aurait pu dire Arthur s’il avait connu notre biâ patois poitevin. 8 – Pas le sèr comme la rosée putou. – Le peut être cope-chou, ou mécanique ou électrique. 9 – Partiras. – Roland a buffé dans l’sin à Roncevaux, mais l’histoire dit pas s’il en avait un o pé, pasqu’o l’arait fait bouétouzer. – Le bat le roi et sa dame s’il est pas copé. 10 – Petit bru métallique au flipper. – Apoués de facin à repouser le râtelet. 11 – Nétchue. – Unité de capacité qui vaut deux chopines et pas tout-à-fait, si ol est de de la bière, o dét caler le jabot. 12 – Cheveille qui supporte la balle au golf. – Vessaïe, à pas lâcher en compagnie de préférence. – Endret vert et repousant au biâ mitan dau désert. 13 – Prind part à une réunien, ou bé aide un chirurgien ou un tchusiné. – Ol est ce qu’on fait quinte on reminte de l’eau dau find dau pouet.
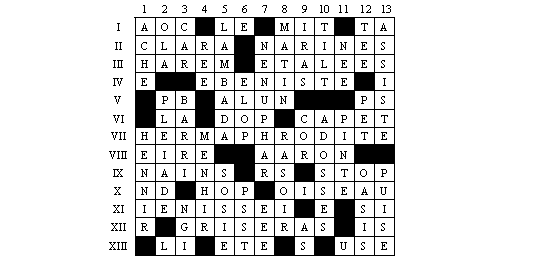
Parcours de guerre
NORÉ, UN POILU PARMI TANT D'AUTRES
Arlette DOMINEAU
En ce début de vingtième siècle, au fin fond de la campagne française, l’essor industriel et les débuts de l’automobile sont encore bien loin d’avoir bouleversé la vie de privations et le labeur quotidien.
Malgré tout, les hussards de la République, depuis quelques décennies, s’efforcent d’ouvrir l’isolement rural à la connaissance et aux perspectives du progrès technique.
En même temps, ils doivent cultiver chez les élèves un esprit revanchard à l’égard de l’Allemagne qui, en 1871, a annexé l’Alsace et la Lorraine.
Pourtant, en ce bel été 1914 qui offre ses belles promesses de récolte, le paysan bavarois et le fermier poitevin sont loin de se douter que les menaces de guerre sont imminentes.
Malgré la mobilisation de Jaurès et des Pacifistes, l’assassinat de l’archiduc suffira comme prétexte à un affrontement de quatre ans fauchant l’essentiel d’une génération de jeunes hommes.
Julien, Louis, Paul, Edmond, Pierre, et tous les autres mobilisés ont grossi les troupes,
Noré aussi : né en 1878, il avait été appelé à vingt ans pour un service militaire presqu’ordinaire en 1898, Noré avait tiré le numéro 41 au canton de Lusignan.
Comme son frère aîné était encore au service, il ne fut que soldat de deuxième classe et affecté au régiment d’infanterie de Poitiers à compter du 14 novembre 1899. Il savait lire et écrire mais ne savaient pas nager (à Saint Sauvant, peu de jeunes gens savait nager à cette époque) …
On allait lui demander de marcher dans l’infanterie et ça, il savait le faire !
A cette époque là, c’était encore le meilleur moyen de se déplacer sans avoir recours à un cheval ou un voiturier !
Il était apte au service et au tir au fusil, il avait été sélectionné en première classe : il avait tellement gagné d’objets au tir à la carabine au club du grand Breuil dans ses dimanches de sorties !Noré, pas malheureux au service militaire, il aimait chanter avec les copains de régiment, les chansons n’étaient pas toutes romantiques mais elles louaient souvent un patriotisme exacerbé en prolongement des maximes de l’école …
« France :
« Et toi ma belle France
Te voilà donc trahie
Livrée vendue je pense
L’armée aux ennemis
Conservons l’espérance
Tous nos soldats sont là
Pour délivrer la France
Nous a dit Gambetta… »
Les informations dans les campagnes circulaient grâce aux colporteurs, par « Le Petit Journal » aussi bien sûr, les abonnés étaient plutôt rares et les nouvelles arrivaient surtout oralement.
Après une année de service militaire, il reste dans la réserve de l’Armée active jusqu’au premier novembre 1902. Il est mobilisable dans la Territoriale jusqu’en 1918 et sa libération définitive échoit en 1924, à 46 ans !
Comme ses frères, les jeunes libérés firent des projets et s’installèrent dans une vie rurale laborieuse mais heureuse. Les couples élevaient leurs enfants près des parents vieillissant.
Mais les relations politiques n’étaient pas rassurantes et cette fragilité s’avéra dramatique quand il fallut renforcer les troupes au front. Réquisitionné à trente six ans, Noré devait lui aussi, comme les frères, les cousins et voisins, abandonner familles et récoltes pour servir la Patrie : les métives à peine battues, il partit pour Poitiers dans un premier temps, il avait pourtant bien rêvé de voir naître ce deuxième bébé qui devait arriver le mois suivant … peut-être un gars pour lui succéder dans sa vieillesse, il s’appellerait Jérôme …
Résolu d’accomplir son devoir de patriote, il obéit, il n’avait pas le choix ! « Bientôt, la victoire les ramènerait bien vite dans leurs foyers ».
Le sept août à Poitiers, de la cinquième compagnie du 68ème territorial, il passe à la 14ème compagnie des dépôts jusqu’au 3 décembre.
Fin septembre, alors qu’il venait d’embarquer en train à Parthenay pour Nancy, la « menine » vint au monde et la nené devait aider la jeune maman à élever les filles, ses « petites », faire la « couvraille » avec ses vaches en attendant son retour.
Passé à la 29ème du 325ème de ligne, le 9 décembre 1914, il est retourné à la 14ème du 68ème territorial …
Il suivit une formation dans les « transmissions » et apprit le morse en même temps que le fonctionnement du télégraphe.
Parti de Poitiers, il rejoint Parthenay et arrive à Faulx le 1er mai 1915.
15 octobre au 212ème de ligne dans les bois de Trappes, de la Fourasse.
Relevés et embarqués en auto à Vélaines, à Mazerulles et pour les avant-postes à la gare de Montcels sur Seille : 4 jours de première ligne, 4 jours de deuxième ligne … 1916, à Mazerulles jusqu’à la relève au Tramblais.
… Verdun : alertes à Ludres, Ligny sur la ligne de Bar le Duc. Couché à Vélaines en Barrois, Sommedieu près du fort de Rozelier, Noré est allé travailler dans les bois des Ramiers, au fort, à la ferme, en carrière, au camp …
En permission, il a travaillé à la ferme de Mandre.… Parti en autobus, première ligne, camps des Pommiers, de Verrières , couché au camp des Fougères.
Bulainville, Verdun Nubicourt au téléphone, couché dans un bois … en réserve au fort de Souville.
… Monté à l’attaque … stage de colombophilie, planter des patates en repos, se laver, se raser en permission, recoudre les boutons, les coutures des souliers délabrés dans la boue, mettre son carnet de bord à jour et rêver avec la photo de la famille, passer le temps avec un poinçon et des douilles d’obus, les angoisses et les nostalgies se succèdent dans la grande précarité des abris de fortune en forêt et en tranchées …
1915, 1916, 1917 … sont interminables si loin de la petite maisonnée dont les nouvelles sont si rares.
Le régiment dissout, il est passé au 226ème avant d’embarquer en train.
… Et 1918 arrive : l’Aisne, l’Alsace, les Vosges, à pieds, en auto, en train, et toujours les mêmes programmes : premières lignes, repos, relèves, avant postes, embarqués, débarqués …
Puis l’Oise, les Vosges, l’Oise, l’Aisne … une gastro-entérite, des piqûres et 20 jours de permission à attendre à l’hôpital.
… Le 11 octobre, rhabillé avant de partir près de Compiègne, il arrive au centre de ralliement de Dunkerque fin septembre.
… Un court séjour en Belgique, passage aussi bref en Allemagne, Noël à la gare d’Aix la Chapelle, la démobilisation le 27 janvier.
… Noré n’arrivera qu’au soir du deux février 1919 à Poitiers.
Enfin chez lui, sale, fatigué, rongé par les poux, il ne veut pas rentrer dans la maison sans faire un brin de toilette à la coussotte de la citerne, il abandonne ses hardes avant de retrouver les siens : ceux qui ont tenu le coup, desparents épuisés sont morts, des amis tués ne reviendront pas …
Alors, la « menine », elle avait maintenant plus de quatre ans, intriguée, demandait à sa maman : « Tchi qu’le vint faire tchô gars …Va-t-il pas s’en aller bintout d’ma chambre ? » « Qui est cet homme ? Il ne va pas s’en aller de ma chambre… »
Elle n’avait jamais vu son papa.
Sûr que Noré revenait de loin ! Et lui, il avait eu la chance de revenir !
Et dans son paletot, il rapportait tous ses petits trésors pour ne plus jamais parler de ses horreurs de guerre.
La page était tournée.
Transcription de la première carte adressée par Noré à sa femme :
Le 22 septembre. Ma bienaimée je veux donc te faire part de mes nouvelles qui sont toujours bonnes. Je veux donc te parler un tout petit peu de mon voyage d'hier je suis donc allé à Nancy j'aurais bien voulu que tu aurais été avec moi pour faire cette permission. Je me suis promené dans un milieu où je connaissais personne et toute la journée nous avons passé à Champigneulle où c'est une chic petite ville avec sa belle brasserie de bières ensuite à Maxeville où il y en a une autre et beaucoup de bateaux qui sont à la charge et à la décharge sur le beau canal du Rhin et les magnifiques hauts-fourneaux et je puis même te dire que depuis Gustin à Nancy c'est que des usines et hauts-fourneaux. Ensuite nous avons arrivé dans les belles rues de Nancy qui sont droites ce qui fait leur charme la 1ère église que nous avons vu a reçu le 1er obus tiré sur Nancy elle a dans la façade un trou grand comme une demie barrique seulement extérieurement nous avons visité les beaux magasins aussi les magasins réunis qui sont épatants nous avons été à la cathédrale et la grande poste nous avons donc passé dans les plus belles rues aussi le marché avec deux halles avec une cour entre les deux. Jamais tu ne peux croire les femmes qui sont à courir et qui en passant à côté pour qu'on les ennuie pas. Je suis donc très content de mon voyage mais ce que je regrette c'est de ne t'avoir pas à mon côté car pour des vues pareilles il faut ouvrir les yeux. Oh ma bienaimée j'aimerais mieux te le dire que te l'écrire mais quand, enfin espérons toujours que ce jour viendra pour nous voir et te serrer dans mes bras. Reçois de celui qui ne t'oubliera jamais les plus doux baisers qu'il t'envoie.
Souvenirs
PLUMES ET DUVETS
Arlette DOMINEAU
Dans un nuage de poussière dorée où flotte plumes et duvets, le joli troupeau d'oies revient du pré.
Les houppes blanches fleurissent les orties poudrées de soleil : " la plume est mure ".
Les femmes s'affairent et préparent la précieuse récolte de duvet : la belle paille blonde d'orge tapisse la courette et les oies sentent bien que ces précautions leur réservent un égard particulier ...
Depuis quelques jours, elles ne vont plus glaner dans les chaumes. Elles caquettent et, le cou tendu, sifflent, le bec menaçant.
Cette matinée sera longue. Les deux femmes se dirigent vers le lieu sacré, une chaise sous le bras, le fichu noué sur les cheveux, le tablier jusqu'aux sabots. Elles s'isolent dans un calme étrange qui ne supporte pas les enfants : cris, gestes malheureux, risqueraient de perturber les oies et l'affolement ferait s'envoler plumes et duvets.
La grande " basse " plate est déjà sur la paille et le sac de jute, marqué à l'encre violette, vient d'être posé pour en vérifier la tare : les marchands auraient tôt fait de s'égarer à la livraison et une livre de duvet ne vaut-elle pas un prix d'or ... La récolte sera bonne : cinq ou six kilos de plumes, trois kilos de duvet, gonfleront les sacs et les enfants résisteront mal au plaisir de s'enfoncer dans les gros ballots légers et si doux.
Pourtant, en grandissant, j'ai eu le privilège de passer la grande porte, et là, dans la mi-obscurité, le rite a dévoilé ses secrets : bien campée dans sa petite chaise, grand-mère vérifie la maturité de la plume en caressant le ventre du premier " piron " pris. Les opérations peuvent commencer. Maman saisit le jars par le cou et les ailes, s'assied et, d'un geste ferme et doux à la fois, le renverse entre ses genoux, la tête pendante, entre les plis de son tablier.
Elle soulève les plumes : " les tiges ne sont pas coupées ". Le duvet est là, doux et chaud, sans résistance puisqu'il est bien mûr.
Elle en pince une poignée et, d'un coup sec, tire une houppe blanche, puis, la libère sur le nuage floconneux qui remplit la " basse " : après un petit cri de surprise, l'oie s'habitue vite et patiente. Son ventre, duveteux tout d'abord, se dénude petit à petit, devenant rose, comme dévêtu.
La mue se termine : le troupeau se retrouve pour partager ses émotions, libéré et désemparé de se voir ainsi plumé. Les oies se congratulent et se réconcilient avec leur nouvelle livrée. Elle se dressent, écartent les ailes, volettent et apprécient la brise qui les caresse. Les voix s'apaisent, la file indienne se constitue et elles repartent lentement vers les chaumes.
Elles reviendront, le cou déformé par un jabot gorgé de grains et, la nuit tombée, s'endormiront dans le calme piaillement des oiseaux repus.