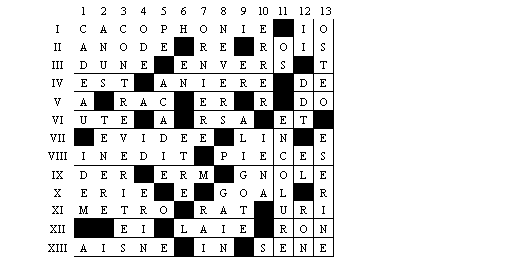
SOMMAIRE du Numéro 17 :
La justice au XIXème siècle : Quatre saint-sauvantais au bagne
A l'école de Nillé : La boulite à la maîtresse
Parfum d'autrefois : Ah bon ... Ah bon ?
Mots croisés : La grille à Suzanne
Source de vie : Eau précieuse mais pas toujours "courante"
La justice au 19e siècle
QUATRE SAINT-SAUVANTAIS AU BAGNE
Michèle LAURENT
On allait vite au bagne au 19e siècle. C’est ce que l’on a pu découvrir l’an dernier, lors de l’assemblée générale de la Boulite où Michèle Laurent est venue parler des bagnards de la Vienne, thème de son récent ouvrage1. Parmi les 1.100 bagnards qu’elle a retrouvés en archives, quatre Saint-Sauvantais. La triste histoire de son ancêtre, Joseph Levenac, de Marnay, mort d’épuisement au bagne de Brest, lui a donné envie d’en savoir plus, d’où ce livre. A sa causerie, elle était accompagnée de Mme Bastière, de Mignaloux-Beauvoir, qui présentait quelques objets fabriqués par des bagnards, venant de son grand-père, ancien gardien de forçats. Merci à toutes les deux.
Dans l’histoire de la répression, les bagnes portuaires, nés en 1748, ont succédé aux galères créées en 1560, quand les progrès de la marine avaient amené la suppression des bancs de rameurs. Les bagnes de Toulon, Brest et Rochefort deviendront alors des lieux d’exécution des peines. Ils fermeront l’un après l’autre, Rochefort en 1852, Brest en 1854 et Toulon en 1873. Les bagnes coloniaux mis en place sous Napoléon III prendront leur suite.
Aujourd’hui, lorsque l’on parle de répression, de punition, la prison nous apparaît tellement évidente que l’on a du mal à s’imaginer qu’à ses côtés a existé, jusqu’au milieu du 20e siècle, une autre institution punitive, le bagne, « formidable machine à faire le vide », comme le disait Albert Londres. Alors que la prison maintenait l’homme puni au coeur de la cité, avec l’espoir de l’amender, le bagne l’exila, et, dans sa version coloniale, l’exila très loin et souvent pour toujours.
Les bagnards de Saint-Sauvant
Presque toutes les communes de la Vienne comptent dans leur population au moins un bagnard. Saint-Sauvant ne déroge pas à la règle ; j’en ai dénombré quatre.
Jean Douhet, né à Saint-Sauvant le 18 juillet 1813, fils de Jacques, tailleur d’habits, et de Marie Alleau, est domestique et décrotteur. Récidiviste, il est condamné, en 1832, à 5 ans de travaux forcés2, pour vols qualifiés3 chez Gabriel Lageon, son logeur. M. Lageon, aubergiste de son état, avait l’habitude de garder son argent dans une boîte, dans l’une de ses armoires. Jean pénétra par effraction dans ladite chambre, força la serrure de l’armoire et fit un trou sous la boîte, ce qui lui permit de voler l’argent en toute discrétion (25 francs environ). Son forfait accompli, il partit à Poitiers faire la fête. Les soupçons se portèrent immédiatement sur lui, car il sortait juste de la prison de Fontevrault où il venait de purger une peine de 4 ans pour vol avec fausses clés. Il a bien essayé de faire porter le chapeau à sa soeur, mais les juges ne furent pas dupes et le condamnèrent, le 29 février 1832, à 5 ans de travaux forcés. Envoyé au bagne de Toulon, matricule 25362, il y décède le 10 janvier 1833.
François Pouilloux dit Capot est né à Messé (Deux-Sèvres). Agé de 46 ans au moment de sa condamnation, il exerçait la profession de voiturier à Saint-Sauvant. Il est condamné à 6 ans de travaux forcés, le 29 juillet 1841, par la Cour d’assises de la Vienne, pour un vol de blé et d’avoine, commis la nuit, avec une échelle et après avoir brisé une fenêtre, dans un bâtiment dépendant d’une maison habitée appartenant à François Bruneteau4. Envoyé au bagne de Rochefort, matricule 13372, il décède à l’hôpital de la marine le 5 septembre 1846.
Aujourd’hui, François Pouilloux, pour des faits similaires, serait passible du Tribunal correctionel et non pas de la Cour d’assises. Il risquerait au maximum 5 ans de prison assortis d’une amende.
Pauline Neuillé est née à Saint-Sauvant, au Grand Sairé, le 30 juillet 1841, fille de Louis et de Marie Rivaud. Domestique, elle est condamnée avec circonstances atténuantes pour infanticide. Pauline avait déjà eu trois enfants, le premier était décédé quelques jours après sa naissance (les juges soupçonnèrent un premier infanticide masqué), le second était élevé par ses grands parents, le troisième avait été mis à l’hospice à sa naissance. Elle est condamnée le 25 mai 1864 aux travaux forcés à perpétuité. Elle est allée aux prisons de femmes de Limoges et de Rennes, mais on ne sait pas où elle allée au bagne. Aujourd’hui, le crime de Pauline serait toujours passible de la Cour d’assises.
Daniel Vincelot est né à Saint-Sauvant le 1er avril 1846, fils de Jean et de Marie Varennes. Il demeure dans les Deux-Sèvres, sans plus de précision. Condamné à perpétuité le 4 décembre 1886 par la Cour d’assises de Niort pour infanticide6, il est envoyé au bagne de Toulon, d’où il embarque le 11 mars 1867 sur « L’Isis » pour la Nouvelle Calédonie, où il est probablement décédé. Rares ont été les hommes condamnés pour infanticide. Ce crime était le plus souvent l’apanage des femmes : 53% des femmes jugées en Cour d’assises ont été condamnées pour ce crime dans la Vienne.
Les bagnes portuaires : Rochefort, Brest, Lorient, Toulon
Reliés les uns aux autres par une chaîne qui leur entravait le cou, les forçats, jusqu’en 1836, rejoignaient leur lieu de détention à pied en sillonnant la France, marqués pour la plupart au fer rouge.
Les forçats condamnés à perpétuité voyaient, jusqu’an 1848, leur peine assortie de la mort civile. Ils perdaient alors toute existence légale, ne pouvaient plus hériter, et leur mariage était dissous.
Très vite les bagnes portuaires (Rochefort, Brest, Lorient, Toulon) posèrent problème. En effet, les forçats concurrençaient la main d’oeuvre locale libre des ports et, en se mélangeant à elle, répandaient des idées funestes qui effrayaient, parfois, les autorités. De plus, la Marine évoluait. En entrant dans l’âge du fer et de la vapeur, pour la construction et la propulsion de ses navires, elle ne requerrait plus l’usage des bagnes devenus obsolètes, comme l’étaient devenus les galères un siècle plus tôt.
Les bagnes coloniaux, souvent à vie : la Guyane et la Nouvelle Calédonie
Par décret du 27 mars 1852, Napoléon III institua alors officiellement un bagne en Guyane pour les condamnés de droit commun. Il s’agissait « d’envoyer la racaille loin de la métropole et de réserver le travail dans les arsenaux aux gens honnêtes ». Il s’agissait aussi pour l’Empire d’éloigner géographiquement les opposants politiques, une technique que la République reprendra plus tard à son compte, concernant les Communards relégués en Nouvelle Calédonie. Les bagnards vont ainsi participer à l’effort mené par la France en pleine expansion coloniale. Pour le pouvoir en place, quel qu’il fut, le forçat aura toujours été une force de travail à bon marché qui aurait dû se transformer par la vertu salvatrice du travail et le changement de milieu.
En 1854, le 30 mai, la loi sur la transportation est promulguée. De manière à être bien sûr que ces « indésirables » ne reviennent pas sur le territoire métropolitain, l’article 8 précise que « tout condamné aux travaux forcés sera envoyé automatiquement au bagne en Guyane ». Si c’est pour moins de 8 ans, il devra, à sa libération, rester en Guyane un temps supplémentaire au moins égal (c’est le « doublage ») ; si c’est pour 8 ans ou plus, il y restera à vie.
Le premier convoi quitte Brest le 31 mars 1852, avec à son bord 300 transportés (condamnés de droit commun), pour les Iles du Salut. Dans les premières années, le taux de mortalité des condamnés et de leurs surveillants atteint 26%, alors qu’il n’est que de 2% pour la population locale. Paludisme, fièvre jaune, dysenterie ont raison des organismes mal nourris et soumis à des travaux très durs.
En 1864, les transportés métropolitains sont dirigés vers la Nouvelle Calédonie, terre jugée moins insalubre. Les condamnés de nos colonies (Algérie, Tonkin, Annam, Gaudeloupe, Martinique, etc...) continuent d’être dirigés vers la Guyane.
Le 27 mai 1885, la loi sur la relégation est promulguée. Désormais une nouvelle catégorie s’ajoute à celle des transportés et des prisonniers politiques : les relégués. Ce sont des récidivistes condamnés à trois peines relevant du Tribunal correctionnel, comme par exemple les vagabonds, ceux qui sont en rupture de ban ou les petits voleurs. De nombreux individus seront touchés par cette loi. N’oublions pas que nous sommes en pleine révolution industrielle ; le pays compte beaucoup de pauvres gens. 1885 c’est l’année où Emile Zola écrit Germinal.
Vers l’année 1887, la transportation reprend vers la Guyanne ; elle est définitivement suspendue vers la Nouvelle Calédonie en 1897. Tous les convois partiront désormais vers la Guyane.
Je ne brosserai pas le tableau de l’évolution de la structure du bagne. Disons que vers 1887, il n’y a plus un seul mais plusieurs lieux de détention en fonction de la nature des prisonniers. Certains sont affectés en ville à des travaux d’intérêt général ou de dosmesticité (c’est le sort le plus enviable). D’autres sont affectés dans les camps forestiers (près du fleuve Maroni) où le travail est harassant mais les « chances de s’évader » les moins minces. Les plus « dangereux » sont regroupés dans l’Ile Royale. Les « incorrigibles » sont internés au coeur de la forêt amazonienne, à Charvein et à Godeberg, tandis que les aveugles et les infirmes, classés « impotents » sont regroupés au camp des Hattes. Les lépreux sont isolés sur l’Ile Saint Louis et les condamnés politiques le sont dans l’Ile du Diable, où les courants marins et les requins s’y chargent d’une surveillance efficace et gratuite.
On allait au bagne pour « pas grand chose »
Pourquoi partait-on au bagne ? Dans la Vienne, ils sont près de mille individus, hommes et femmes, à avoir été condamnés aux travaux forcés entre 1800 et 1907 et dont on connaît la destination de détention. Généralement issus des métiers de la terre (journaliers, laboureurs), ouvriers et artisans (terrassiers, maçons, serruriers), certains exerçaient plusieurs métiers : boulanger et journalier. On trouve aussi des colporteurs et quelques membres issus des professions libérales : huissier, 5 notaires, 2 avocats et 5 banquiers dont la famille Collin, de Souvigny. Le père et ses deux fils, originaires du Blanc, organisèrent la faillite de leur banque qui avait pignon sur rue à Poitiers, avant de s’enfuir aux Etats-Unis via l’Angleterre. Jugés par contumace, ils furent condamnés à 20 ans de travaux forcés. Un peu plus d’un siècle plus tard, les choses ont bien changé !
S’il est vrai qu’au début du 19e siècle, on allait au bagne pour « pas grand chose » : 5 ans pour le vol qualifié d’un parapluie, 12 ans pour un vol d’huile chez son employeur, au fur et à mesure que le temps passa, l’application des circonstances atténuantes (1828) et l’évolution des moeurs ont fait que la peine de travaux forcés, au début du 20e siècle, ne fut « réservée » qu’aux crimes que l’on peut qualifier de particulièrement épouvantables.
1938 : le dernier convoi pour la Guyane
Les bagnes, qu’ils soient portuaires ou coloniaux, ont broyé pour rien des êtres humains et, en 1938, il a bien fallu reconnaître l’échec et la faillite d’un tel système.
Les bagnes ont répondu à un souci obsédant au cours du 19e siècle : assurer la sécurité des biens et des honnêtes gens, ce qui en soi est très louable, en se débarassant, en envoyant le plus loin possible, les criminels, les vagabonds, les voleurs, les indésirables, les opposants politiques, les fauteurs de troubles, qui « gangrènent » la société. Dans les interventions des députés à la Chambre, en 1885, préludant le vote de la loi sur la relégation des multirécidivistes, il est question d’ « individus gangrenés, d’errants qui infestent nos rues et nos jardins publics » et de « se protéger en se mettant à l’abri des condamnés ».
N’oubions pas que les atteintes aux biens ont été, tout au long du siècle, sanctionnées bien plus sévèrement que les atteintes à la personne. Ainsi, en 1840, celui qui commettait un viol particulièrement odieux sur un enfant de trois ans n’était condamné qu’à une peine de 5 ans de travaux forcés, quand ce n’était pas à une petite peine de prison, voir une relaxe, alors qu’un journalier qui volait un morceau de jambon pour se nourrir et quelques hardes pour se vêtir, partait forçat pour 5 ou 10 ans.
Avec l’arrivée du 20e siècle, la société évoluera, la guerre de 1914-1918 marquant un changement important dans les mentalités. Le dernier convoi pour la Guyane partira à la fin de l’année 1938. En effet, suite aux interventions réitérées et aux pressions exercées par Gaston Monnerville, alors député de Cayenne, et par le journaliste Albert Londres, décision a été prise, par le président du Conseil Paul Reynaud, de fermer les bagnes de Guyane. Ralentie par le conflit de 1939-1945, cette fermeture ne sera effective qu’en 1953, après le retour des derniers bagnards en métropole.
(1) Michèle Laurent, “Les bagnards de la Vienne”, Le Pays Chauvinois, n°44, 2006, 278 pages.
(2) - Archives Vienne, 2 U 1510.
(3) - Par vol qualifié on entendait un vol commis ave des circonstances aggravantes : vol commis avec effraction, ou de nuit, ou dans une maison habitée, ou encore avec de fausses clés, ou en récidive.
(4) - Archives Vienne, 2 U 2058.
(6) - Registre d’écrou du bagne de Toulon.
A l’école de Nillé
LA BOULITE A LA MAITRESSE
Roger FLEURY (*)
Voici quelques souvenirs d’un drôle de Nillé, Roger Fleury, dans les années 30. Sa mère, Mme Madeleine Fleury, était l’institutrice, la maîtresse. Comme elle devait préparer le repas des élèves, elle avait fait creuser, par son mari, une boulite lui permettant de surveiller sa classe depuis sa cuisine.
Mme Fleury est arrivée à Nillé en 1926. Elle y est restée jusqu’en 1936, alors que le gars Roger avait 12 ans. Elle fut ensuite nommée à Chasseneuil. Cet ancien des PTT, 85 ans, vit dans le Cantal. C’est Yves Larcher, du bourg de Saint-Sauvant, qui lui a fait connaître la Boulite.
Quand la famille Fleury est arrivée à Nillé, dans l’été 1926, nous étions deux frères tout petits : mon frère, Guy, avait un an et demi et moi deux ans et demi. Nous sommes nés tous les deux à Saint-Savinien (Charente-Maritime) où mon père avait travaillé aux chemins de fer, Compagnie de l’Etat. Ma grand- mère était garde-barrière.
Du ventre de ma mère à la classe
Arrivé à Nillé, mon père a continué sa vie de 36 métiers 37 misères.
Il a été été marchand de poissons. Il se ravitaillait à la gare de Rouillé où s’arrêtaient les trains de la Rochelle qui lui apportaient poissons et coquillages. Il faisait des tournées à Saint-Sauvant et aux environs, jusqu’à Ménigoute.
Il a ensuite été porteur de pain à la coopérative de Saint-Sauvant tenue par M. et Mme Barrault.
Je n’ai quitté le ventre de ma mère que pour passer de la cuisine familiale à la classe et à la cour d’école. Comme elle ne pouvait pas nous faire garder, elle nous prenait avec elle dans la classe, tout petits, mon frère et moi, à un an et demi et deux ans et demi. Nous avons appris à compter, écrire, lire, à quatre ou cinq ans, dans la classe, avec les autres.
A Nillé, ma mère avait une classe unique. La photo ci-jointe est de 1935. Elle avait cette année-là, sa dernière année, 32 élèves de 3-4 ans à 11 ans. Ils venaient d’un peu partout aux alentours, par n’importe quel temps. De l’Eterpe, Anne-Marie, Chasseigne, la Chapelatière, la Litière. Parmi les élèves de mon âge, je me rappelle bien d’Yvon Coineau, devenu marchand de vin dans le bourg.
De la géographie aux doryphores
Ce qui me frappait à l’époque, c’étaient les cartes de géographie, en carton costaud, toilées au bord, de la maison Vidal-Lablache. Un côté était explicatif, l’envers était muet. Après la leçon, la maîtresse tournait la carte et interrogeait les élèves.
C’est à l’école de Nillé que j’ai vu les premiers mots en latin, sur une belle affiche : Nens sana in corpore sano (Une âme saine dans un corps sain). C’est peut-être le Dr Ferraris qui l’avait donnée à ma mère. L’affiche était au dessus du lavabo émaillé en deux pièces acroché au mur. Tout le monde devait se laver les mains en entrant en classe.
La maîtresse nous faisait faire des sorties utiles. Nous allions à la chasse aux hannetons et aux doryphores. Nous avons bien rigolé pour le premier essai d’extermination des hannetons par ma mère qui les jeta au feu. Mais ceux-ci se sont bien vite envolés. Nous, les enfants, on était heureux.
Pour les doryphores, dans les champs de pommes de terre, nous ramassions les adultes, les larves et les feuilles garnies d’oeufs. C’était plus facile à récolter que les hannetons.
La boulite à la maitresse
Cette fâmeuse boulite, que ma mère avait demandé à mon père de creuser dans le mur obligeait les élèves, qui se savaient surveillés, à se tenir tranquilles. Elle permettait aussi de passer les fils électriques pour éclairer la classe.
Cette boulite fonctionnait aussi à l’envers. Un lundi matin, la maitresse a demandé à tout le monde de montrer le devoir de français prévu le samedi. Je ne l’avais pas fait. J’ai dit à maman : « Je ne trouve pas le cahier, j’ai dû le laisser dans la cuisine ». Elle m’a demandé d’aller le chercher, m’a regardé par la boulite et elle a compris. « Roger, rentre dans la classe ». Là, j’ai pris une avoinée carabinée.
Nous avions comme cahiers de brouillon des cahiers de publicité des cirages Lion Noir et Mayola, des chocolats Ibled et Neslé. Ces fournitures étaient gratuites. Tous les élèves en avaient.
Des histoires de gamins
Avec mon frère, nous n’étions pas les meilleurs élèves. Un soir, dans la cuisine, mon frère a dit à ma mère qu’il n’y avait pas de leçon de grammaire pour le lendemain. Il s’occupait à autre chose. Ma mère l’a pris par le collet de son tablier noir, l’a conduit dans la classe, a allumé la lumière, et l’a mis devant le tableau où il a pu lire : « 1ère heure : leçon de grammaire ».
Un jour, il y avait une fête familiale dans le village. Des fiançailles, un mariage ? Les gens dansaient l’après midi. Avec les copains, on a attaché des ficelles de lieuse les unes au bout des autres pour traverser la salle de danse. Personne n’y avait fait attention. On est juste restés le temps que la ficelle fasse son effet. Les gens ont trébuché et on est vite partis.
Le voisinage
Dans un récent numéro de la Boulite, à propos des batteries dans notre secteur, il est question de Eugène Seignerin. C’était notre voisin, en face de l’école. Je me souviens bien de lui, de sa femme Victorine et de leur chien Tango. Victorine, qui était plus vieille que ma mère, était née Bouquet. Elle me disait en riant : « Dommage qu’on n’est pas mariés ensemble : on aurait fait un joli bouquet fleuri ! » Leur belle-soeur, qui habitait un peu plus loin, nous faisait manger du fromage mou qui sortait tout juste de la faisselle.
On a été accueillis à Nillé comme les enfants du pays. On allait garder les vaches. On parlait patois, un peu... La fiente de poule ol était « daus eûs sans cracotte (sans coquille) ». On les connaissait les ajhasses et les groles, et bien d’autres choses, les gueurlets ...
Il y avait aussi le père Delouche, qu’on appelait « Pompélou », le pépé Delouche. Quelqu’un d’indipensable dans le village. C’est lui qui collait les affiches municipales. Il repeignait à la chaux l’endroit où il collait ses affiches avec de la colle faite de farine et d’eau. Les chèvres, quand elles passaient, avec leurs betchions, bouffaient tout si la farine n’était pas sèche. Il exerçait également la fonction de vidangeur. Il nous disait qu’il faisait çà parce qu’il était le seul du village à ne pas avoir peur de « s’asfier » (pour s’asphyxier). C’est lui qui nettoyait les waters à l’école. Trois loges en bois surmontaient trois pierres percées. Du côté des filles, un trou unique. Du côté des garçons, deux trous dont un petit pour faire pipi. Entre les deux, le water de la maitresse.
Je me souviens des autres gens du village. La grand’ mère Roulleau ; Honoré Martin ; les Belin, Lucia et Adolphe ainsi qu’Odette leur fille aînée, qui a failli devenir aveugle en faisant du caramel, le plat lui ayant sauté à la figure ; les Bourron (Bourron et « la Bourroune ») ; les deux frères Magnien, dont un est mort d’une hernie étranglée; les Minault qui étaient laitiers; les Bonnifet et les Vincelot.
(*) Souvenirs recueillis par Guy Puaud
À bon ... Ah bon ?
Suzanne POINSTEAU
Autefoués on disait : o sent à bon, cela sent bon. A s'a mis de l'odeur ou dau sent bon. Elle a mis du parfum, lequel parfum, à l'époque, n'était autre que la bonne vieille eau de Cologne qu'on appelait précisément dau sent bon. On l'utilisait uniquement le dimanche, à raison de quelques gouttes sur le coin du mouchoir ou de la serviette à débarbouiller (il n'existait pas de gant de toilette).
Pour faire bisquer les petits quand ils sentaient bon le savon et l'eau de Cologne, les taquins leur disaient : tu pues ... oui mais tu pues à bon.
La bouteille de sent bon était utilisée avec parcimonie. Elle durait une année ; il n'existait pas de conditionnement d'un litre à cette époque ! On attendait patiemment les étrennes suivantes.
O f'lait épergner. Il fallait économiser ces doux effluves.
LA GRILLE A SUZANNE
Suzanne Poinsteau
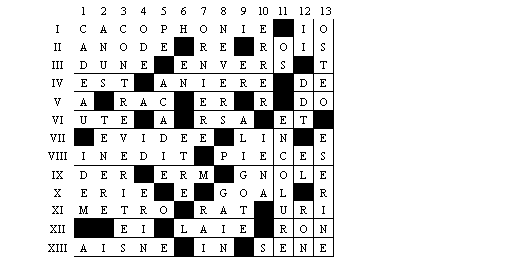
De gâche à drète
I – Ol est putout dau chastafrin que de la musique, surtout si les musiciens jouont faux. – Tchelle particulière qu’a été changeaïe en taure. II – Electrode qu’est pas la cathode. – Deuxième note de la gamme. – L’ont ieux galettes à l’Epiphanie. III – Tchelle dau Pyla fait dépiacer bin dau minde. – Ol est d’même qu’o f’lait pouiller son panetot peure pas être ensorcelé. IV – Directien de Nancy par rapport à Paris. – Une particulière qui s’occupe de daus bardous et de daus bardines étout. – La tailleuse se l’met au bout dau det. V – Avec ric o veut dire qu’ol est mé que jhuste ! – Fin d’infinitif dau peurmé groupe. – Peurmère note de la gamme. VI – De l’Utah i m’doute. – On dirait qu’un tsunami a chamboulé tchelle petite bourgade de l’Ile de Ré. – O veut dire qu’ol a une suite. VII – Creujhaïe en enlevant le mitan. – Belle piante à fieurs bleues qui servira à faire de la belle touèle pu fine que tchelle de chanvre. VIII – Qu’a core jamais été entendu ou édité : ol est nouviâ. – Si a sont jaunes, ol intéresse Bernadette et David.
IX – Ultime pli à la belote et qui vaut dix. – Une mer démintaïe. – Eau-de-vie. X – Lac américain. – Gars qu’est « dans les bois » peure acoter le ballon. XI – Si à couté ol a que « boulot » et « dodo », ol est guère amusant. – Un bétiâ pas grous, mais qui fait grand pou à tout pien : le vive entre autres dans les égouts. – Canton voure que Guillaume Telle a nétchu. XII – Jhuste au biâ mitan dau rein. – Ol est la mère aux marcassins, mais ol est étout un chemin tout dret en pien bois comme o serait la grand’ligne. – Et … et … petit patapon. XIII – Département picard qu’a Laon comme chef-lieu. – A la mode, un peu dandy. – Piante purgative.
De hât en bas
1 – Tchau dau Père Noël est souvent pu biâ pasqu’el a dau biâs rubans. - Mot qui veut dire qu’ol est dau pareil au même. 2 – Un endret voure que le proctologue va musser, beuiller et même bireuiller. – Régien désertique dau sahara nigérien. 3 – Tout uniment ol est comme qui dirait daus menteries. 4 – Aut’foués, poème chanté. – L’abréviation de tchau mot qui veut dire pareil. – Le nin poétique de l’Irlande. 5 – Un début de péritonite. – Régien formée par les provinces maritimes dau Canada. 6 - Dans. – Un auxiliaire. 7 – Rouin, que s’il est grous on peut s’entouyer. – La mouétché d’un raisin. 8 – Chef-lieu dau département de la Nièvre. – A l’opposé de la perte. 9 – La deuxième note renveursaïe. – Vin bian de Bourgogne. 10 – Baguenauder, pas savère voure aller. – Victoire de Napoléon qu’a douné son nin à un pont. 11 – Tibia ou humérus ou malléole ou … ou … - Dans un pull par exemple, passage aménagé peure passer la tête et le cou. 12 – Bessounes rouges d’apra Arthur. – Puissant insecticide. – Article ibérique. – Core : et … et … petit patapon. 13 – Dans un mot, radicale qui signifie les « ous ». – Poésin mortel : sus la pupille de l’œil, al a l’effet contraire de l’atropine qui la rétrécit .
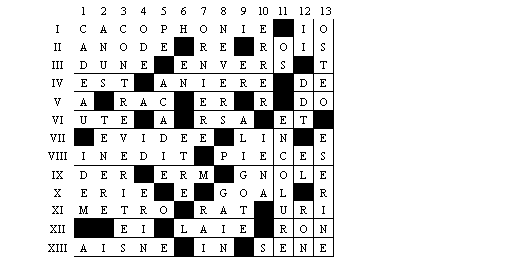
Source de vie
EAU PRÉCIEUSE
MAIS PAS TOUJOURS « COURANTE » !
Arlette DOMINEAU
Á « Saint Sauvant la Plaine » le calcaire est fissuré sur la moitié sud de la commune, le nord est couvert d’argiles rouges ferrugineuses perméables et fertiles. Les eaux de surface infiltrées, la rivière ne court plus depuis fort longtemps. Aujourd’hui, dans le lit de cette rivière disparue, les pluies d’hiver et de printemps engorgent parfois les sols pour quelques jours de crues exceptionnelles. L’eau des champs s’écoule alors vers la Dive et la Sèvre selon les caprices des failles.
Au « champ de Jassay », près de la Litière, Jean Gervais a trouvé deux très belles haches de silex. A la Chevraise, les enfants de l’école ont aussi récolté les silex perdus dans les vases de la mare où s’abreuvaient sangliers et chevrettes des bois ! Les marigots, les mares, même temporaires, ont toujours attiré les grands gibiers et les chasseurs.
Dès la préhistoire, en lisière de forêt, les terres fertiles hébergent les campements qui n’ont pas laissé que des silex taillés dans les champs, leurs sites ont évolué selon leur savoir faire. Guy Puaud dans les « Archives du sol » analyse et repère les sites moustériens, néolithiques de la commune. Il a, d’autre part, retrouvé dans « Les noms de terroirs » leur lien avec cette rivière devenue virtuelle : « le gué Deriou », « la Gasse au chien », « le Crotté », « les Egauts », « Nillé » …
La rivière, les ruisseaux se sont faits si discrets que seuls les puits marquent encore le lit abandonné de son cours supérieur. Ainsi, au « Pian dô pouet » à Chasseigne, à Montlorgis … les puits en restent de vénérables témoins. Et comme l’eau de pluie ne reste pas longtemps en surface seules quelques mares ont été restaurées au siècle dernier et subsistent encore aujourd’hui.
Santé fragile : attention, danger !
Sans eau courante, comment s’approvisionner en été ?
Boire l’eau croupie des « bassines » de toutes sortes, « timbres », barriques, cruches, avait des conséquences désastreuses pour les intestins fragiles : coliques, dysenteries, maladies, empoisonnements … Les « grenouilles dans le ventre » incitaient plutôt à consommer les jus des fruits, fussent-ils fermentés, ils ne donnaient pas les mêmes coliques …
Ignorait-on les conséquences de l’alcoolisme ? Les piquettes de prunelles, de groseilles, le cidre, le poiré, le vin … même « allongés » avaient détrôné les vertus de l’eau tristement « plate ». C’étaient pourtant les brouets d’avoine, de navets, carottes, les potées de choux et autres ragouts, les panades qui nourrissaient les hommes d’eau longuement bouillie.
« Mange ta soupe pour devenir grand ».
Puits et citernes au centre des préoccupations des villageois
Les sorciers se sont-ils faits sourciers pour proposer les endroits favorables où capter l’eau si précieuse ? Electromagnétisme, conductibilité … ont aujourd’hui remplacé les observations et la magie de la baguette de coudrier ! Bien sûr, la végétation plus drue, les crues de la rivière intermittente aidaient à choisir le lieu sur le cours de la vallée devenue sèche.
Rassembler les échelles, les perches d’échafaudage en châtaigniers, les treuils, les chaînes et les cordes pour transporter les seaux de gravats … Quel chantier ! Creuser à la pioche, la pelle, remonter au treuil les pelletées, les tonnes de glaise ou de pierres calcaires !
Une opération collective effectuée après les récoltes, quand les terres sont moins collantes et moins lourdes, à la saison sèche probablement. Les robustes puisatiers étaient-ils volontaires ou journaliers pour creuser ?
Tous aussi acharnés, pour remonter et transporter la terre jusqu’au tertre voisin, sécuriser ce trou creusé dans la terre fraîche, étayer, aménager les abords ?
Combien étaient-ils à se relayer à toutes ces tâches ?
Dans le Sud de la commune, sur sol caillouteux peu épais, creuser à la barre à mine dans les strates de calcaire fissuré, rejeter les pierres hors du trou … le travail restait extrêmement pénible et les manches des outils ont souvent mordu la peau pourtant calleuse des puisatiers. Les ampoules, les « tours de reins », les « forçures », entorses et autres accidents plus graves n’ont pas manqué !
Les « piatins » lancés à la main hors du « cratère » s’accumulaient à proximité : une partie a servi à maçonner les parois de l’édifice souterrain, à construire la margelle et les murs des bâtiments voisins. Les fronts suants de ces ouvriers harassés mais confiants du succès de leur labeur, se sont-ils éclairés en touchant les marnes molles gorgées d’eau ? Alors que l’œuvre de terrassement se terminait, construire le conduit en cimentant les bords, consolider pour résister à la pression des éléments fut, sans nul doute, une opération plus rapide. Le monticule de terre encore fraîche allait permettre de hisser sur des rondins, la margelle : une large pierre plus dure, taillée et creusée au burin pour ouvrir la « goule dô pouet ».
Le maréchal ferrant avait forgé à l’enclume les solides montants du treuil de chêne. Il allait venir le fixer avec sa manivelle et une chaîne assez longue pour toucher le fond. La tôle de protection allait coiffer l’édifice au dessus de la margelle. Cette dernière pose devait être une « sacré fête » ! Peut-on imaginer les badauds autour du maréchal ferrant et les premiers seaux remontés dans la liesse, la satisfaction et la fierté de ces hommes ! Pensaient-ils que l’eau de leurs puits nourrirait encore leurs descendants des siècles après eux !
Les puits d’aujourd’hui seraient-ils fleuris pour honorer tous ces efforts ?
Mystères au fond du puits !
Comme les enfants j’étais intriguée par cette mystérieuse margelle et la lourde trappe que l’on repoussait pour y jeter le seau accroché à la chaîne du treuil.
«A Poneuf, à Anne Marie, une biquette était cheute dans le pouet ! Fallait pas boire derrière !»
Les accidents, les suicides avaient fait mauvaise renommée à nos puits et citernes. Et quand « le seille y cheusait », fallait aller chercher le « chat » pour le sortir ! Pour un gamin, y avait rien à y comprendre ! Sauf que les griffes recourbées d’un grappin à grand manche ramenaient des ténèbres tel une proie exhumée de l’obscurité, le malheureux seau cabossé …
Alors, comme tous les enfants qui ont grandi dans la campagne, quand la curiosité m’a enfin autorisée à me pencher pour voir … « la Bête » qui répondait au fond : « Oho ! Oho ! ». Qui pouvait bien répondre et faire écho … oho ? Non, dans ce trou, tout au fond, je ne voyais pas, dans le noir profond et brillant, le monstre caché. Seulement un petit rond de lumière. « Bin, j’vois rin…in…in ! ».
« Oh regarde bin ! » me dit cousin Michel, « tu vois pas au fond ? Le disont qu’ô y-a une « tête d’âne » » ! Ah ça, non ! Au fond, dans le ciel de l’ombre, c’est ma petite tête qui renvoyait mon image et ma voix ! Alors « riant un peu jaune », j’aurais bien voulu arroser le farceur rieur de ma « bobine » dépitée.
Au village, le puits était le lieu de rencontre quotidienne.
Près des halles, les femmes du bourg venaient aux nouvelles en tirant l’eau pour la soupe, la toilette … Pour les animaux, les hommes amenaient les troupeaux au timbre qu’ils remplissaient directement au puits …
Dans les villages, comme à Nillé, le timbre de pierre, creusé dans la roche non gélive accompagnait le puits ou la citerne pour abreuver chèvres, vaches et chevaux. Parfois en ciment, bien décapé à la brosse en chiendent, la fermière venait y laver le linge de la « bugeaie ».
Au puits d’Anne Marie, le treuil déroulait trente mètres de chaîne dans la profonde « cheminée » : celle-ci était si étroite à travers l’épaisse couche d’argile rouge que le seau n’était pas toujours plein quand la chaîne avait donné du ballant !
Puis les pompes à godets ou piston furent installées en même temps que l’électricité dans les rues du bourg! Aujourd’hui, l’adduction d’eau a mis les margelles carrément hors service et le lierre, les fleurs ont remplacé le seau, pour vous éviter de regarder par la goule … les têtes d’ânes !
Eaux de pluie ou eaux de puits ?
Dans la citerne, l’eau de pluie est récoltée par les gouttières des toits. Alors, gare aux « grenouilles dans le ventre » ! Souvenez-vous ?
Et l’eau du puits c’est aussi de l’eau de pluie, non ? Mais celle-ci, tombée sur le sol, a traversé les couches du sous-sol, jusqu’à trouver un lit imperméable où elle circule lentement … lentement vers la proche rivière. Sa qualité dépend des roches traversées, et parfois hélas des pollutions de proximité !
Dans les fermes, les nombreux bâtiments permirent de récupérer ces eaux de pluies dans des citernes enterrées dont les parois étaient maçonnées de moellons soigneusement taillés, cintrés, collés à la chaux … « La pression exercée par la terre aurait pu fissurer les parois : la résistance de l’eau n’équilibrait plus la poussée exercée par la terre voisine pendant la sécheresse » souligne Pierre Villain. « Ils faisaient ça comme une bouteille, une cruche, à peu près deux mètres de profond, comme l’échelle quoi ! Elles étaient bien crépies à l’intérieur».
Au Parc, les Bonnifet avaient encastré des citernes dans le mur de la maison pour servir tantôt les animaux au timbre, tantôt la cuisinière pour les repas. Plus tard, « les maçons ne se sont plus souciés d’arrondir les moellons, leur ciment résistait mieux et ils ont construit des citernes étanches comme les fosses à purin, à base carrée ou rectangulaire », rapporte Michel Bussereau.
Assurer la potabilité de l’eau de la citerne :
Après les deux mois de sècheresse, la citerne tarie, les animaux aspiraient bruyamment avec précautions la surface de la mare dont le niveau avait bien baissé cet été là. Derrière les volets mi clos, affairés autour d’un jeu de patience, les enfants ignoraient tout de l’évènement de la journée : les hommes curaient la citerne.
Avec l’ami Arthur, ils avaient une journée très particulière à partager. A la manivelle du treuil, l’un d’eux lançait des appels au fond de la citerne. L’écho rapportait des « Oh…oh ». Les seaux d’eau brune en sortaient et remplissaient la basse posée sur la brouette … D’où sortait donc cette mixture étrange, grise, sableuse ? Un mystère accru par la peur bleue de ce trou noir après duquel les enfants étaient « interdits de séjour ». Notre imagination échafaudait les hypothèses les plus farfelues. Sous terre, un monde peut-être si étrange !
« Seau ! Oh ! Attention ! » Concentré et sérieux, l’homme remontait ce jus repoussant. Le seau retournait au fond avec un « Seau » de plus et « Oh - oh » en écho. Et il remontait encore plein ! Floc, la brouette dégoulinait … Combien y en eut-il ?
Mais l’étrangeté n’était pas au bout de nos surprises quand papa émergea de la margelle, le béret trempé, la chemise souillée, les bottes mouillées … Il tenait sa pelle et une bougie à la main, et de ce trou noir, il remontait ensuite cette interminable échelle. « Que diable pouvait-il faire de cette bougie dans la citerne ? Mais d’où venait cette échelle ? »
Il raccrochait et vérifiait le fonctionnement de la trappe de fermeture avant de se laver les mains à la coussotte, se jeter des gerbes d’eau claire sur la poitrine et les bras. Il avait l’air soulagé et content quand tout le monde passait à table. En avalant la soupe, je ne comprenais rien à ce qu’ils se racontaient ces adultes :
- « Y’avait pas grand-chose à enlever, cette année, ça a été vite fait, pas de dégâts, le ciment a bien tenu; au fond pas de fissure, les parois sont propres … »
- « Oui, mais avec de jeunes enfants, on ne pouvait pas prendre de risques; les maladies … fallait bien la nettoyer pour être tranquille… »
Mais nettoyer quoi ? Qu’est-ce qui pouvait bien être aussi sale au fond de la citerne quand son eau sert pour se laver et boire ? Et l’échelle, la bougie ? Ma petite tête restait encombrée de questions mais les réponses vinrent plus tard.
Dans la citerne, l’eau de pluie venait des gouttières, des toits, minéralisée par les feuilles, mousses et lichens, les fientes de moineaux … Il est évident que sa qualité biologique pouvait être quelconque voire douteuse et qu’il était recommandé de la faire bouillir, de prélever les limons déposés au fond de cette cruche en curant la citerne de temps à autre. Papa nous expliquait qu’en cas de fermentation, le gaz carbonique aurait éteint la bougie et qu’à ce moment là, les hommes auraient risqué l’asphyxie.
Lors de la construction de l’école de La Forêt, en 1908-1809, les étapes, structures et coûts de la citerne sont notés « aux Archives de la commune » (voir photo pages 23). Pas de risque de pollution : des tuyaux sans plomb et un système de filtres sur sable, graviers et charbon pouvait servir de modèle pour les citernes voisines. Pas de margelle : trop de risques, souvenez-vous des biquettes à Anne Marie et Poneuf ! Dans une école moderne : une pompe inoxydable ! Ah ! La pompe ne fut pas seulement là pour tirer l’eau : combien de punis sont venus partager leur humilité, leur tristesse quand les maîtres les plaçaient là, en face des classes, devant « tout le monde » pour avoir rêvé trop longtemps.
Enfin, quand les pluies remplissaient la citerne, un panier à salade de « pierres de chaux vive » était descendu pour neutraliser la qualité de cette eau. En d’autres circonstances, on y descendait un bocal de sangsues utilisées pour décongestionner les œdèmes, vieille coutume que le médecin de campagne prodiguait exceptionnellement. La ponction de sang que la sangsue prenait en se fixant sur la peau pouvait soulager la douleur. Le village savait où se trouvaient les bestioles salvatrices … qui passaient ainsi d’une famille à l’autre en cas de besoin. Même si les sangsues des fontaines pouvaient jeûner longtemps entre leurs prises de sang, cela ne garantissait en aucun cas la pureté de l’eau de la citerne !
Et quand l’eau courante est enfin arrivée aux robinets, vers 1950 à 60 selon les villages, l’eau de source en garantissait la qualité et coulait à profusion. Oubliés les corvées d’eau, de vase, les grenouilles, les sangsues, même le chat et les têtes d’ânes du fond ! Les contrôles sanitaires réguliers et fiables garantissent la potabilité de l’eau de table. Aujourd’hui, la corvée des bouteilles de plastique peut enfin cesser.
Le prix de l’eau n’a jamais été négligeable
Quelques relevés des coûts pour faire la citerne en 1905 à Anne Marie (dans l’argile rouge du nord de la commune). Les hommes s’aidaient en rendant le « coup de main » par des journées de travail, entre frères et voisins, seuls les artisans et journaliers étaient rémunérés.
- le perçage de la citerne en janvier, février 1905 : 28 francs ;
- huit journées de maçons à trois hommes, pour 86,25 francs.
En avril, les travaux reprennent : deux, trois puis quatre hommes participent au creusement et à la consolidation des parois cimentées.
- 15 barriques de chaux : 108,75 francs ;
- 15 sacs de ciment : 52,5 francs ;
- 20 mètres de tuyaux en ciment pour ramener l’eau des gouttières à la
citerne : 38 francs ;
- dalles (gouttières) : 41francs ;
- montage du tour : 11 francs ;
- sept journées de journalier : 125,5 francs ;
- percer et poser la margelle en mars, deux et trois hommes pendant neuf jours : 71,5 francs.
Total auquel il faudrait ajouter bien sûr les réparations des seaux percés et cabossés et les curages réguliers, l’entretien des tuiles et des gouttières … Sachant qu’à ce moment-là, deux timbres poste coûtaient 0,50 francs, deux boites d’allumettes 0,10 francs, un litre de pétrole 0,50 francs, une paire de sabots : 4 francs. Un pantalon fait par Chamaillard : 10 francs.
Allez, à vos convertisseurs, et consolez-vous, l’eau d’aujourd’hui ne donne plus la colique !
Traditions
O FASAIT POU …
Suzanne POINSTEAU
Permettez chers lecteurs (trices) que modestement je vous fasse un cours de patois :
Si on prononce dans notre patois « dis rin », littéralement ça se traduit par « ne dis rien ». Mais en fait cela sous-entend beaucoup d’autres choses selon les circonstances.
1er exemple : « Dis rin mon valet, crie pas ». trad. : « ne dis rien mon petit garçon, ne pleure pas » (en effet crier ne signifie pas pousser des cris, mais sangloter, pleurer en silence) exemple : « quinte son chat a mouru, tchau pauv’drôle criait toutes les neuts » trad. : « quand son chat est mort, ce pauvre petit pleurait toutes les nuits ». « I t’achèterai daus pastilles quinte le kaïffa passera » trad. « je t’achèterai des bonbons au prochain passage du kaïffa ». Voilà quelques paroles réconfortantes prodiguées à son petit-fils qui a du chagrin, par une bienveillante grand-mère aimante et compatissante.
2ème exemple : « Dis rin mon valet » trad. : « tais-toi sale chenapan », « I t’jhindrai et i te dounerai à la galopine quinte a passera tchau lin » trad. : « Tu ne perds rien pour attendre. Je t’attraperai et te fourguerai à la bohémienne lors de son prochain passage ». C’était là, et vous pouvez m’en croire, un tout autre discours, « une autre chambalète » comme dirait quelqu’un que je connais bien. Celui sur lequel s’abattait ce funeste présage, parce qu’il avait commis une grosse bêtise (il fallait en réalité qu’elle fût énorme), eh bien ce cadet là n’en menait pas large, il était glacé d’horreur, dans un état proche de la sidération au sens propre du terme. Ça ne rigolait pas !
Il arrivait tout de même que cela s’arrangeât … avant le passage de la galopine. Le contrevenant devait faire amande honorable et demander pardon.
À ce stade, je me dois d’expliquer quelque chose que les plus jeunes ou plutôt les moins âgés d’entre vous n’ont pas connu.
Le kaïffa au sens premier est une préparation culinaire orientale composée d’un mélange d’épices, de farine, de fécule de pommes de terre, de riz, de cacao, de sucre etc …
On a appelé kaïffa le vendeur ambulant qui vendait ces produits et d’autres encore – comme du café, des bonbons, du sucre, de l’encaustique, de l’huile … le kaïffa était un personnage hors du commun pour les enfants parce que, entre autres choses il avait une charrette faite à leur taille : c’était un genre de coffre comme celui des colporteurs tiré par un chien parfois, ou poussé par le kaïffa qui faisait donc d’une façon ou d’une autre sa tournée à pied.
Dans un salmigondis de substantifs très approximatifs parce que nous étions loin d’en connaître le sens exact, nous dotions les bohémiens de dénominations aussi fleuries que variées, telles que romanichels, gitans, manouches, coureuses, baladins, roms, tziganes, gourgandines, nomades, galopins, voyous, mais parfois aussi forains quand d’aventure ils possédaient un petit cirque avec un trapéziste, un jongleur, un funambule et un clown avec son chien. Souvent il s’agissait d’une seule et même personne (pas le chien quand même !).
C’était évidemment, et le plus souvent, à savoir de simples adeptes d’une philosophie d’itinérants qui se voulaient libres : une roulotte tirée par un cheval suffisait pour le couple et les enfants (voir croquis ci-dessousde l’Imageur Georges Thaller).
À Saint-Sauvant, ils stationnaient sur la place du Temple. Parfois et même souvent, plusieurs familles arrivaient en même temps : ils avaient l’instinct grégaire très développé. Ils revenaient tous les ans à la même époque et on peut dire qu’ils vivaient d’une façon très spartiate (pas d’eau courante ni pour eux ni pour les riverains d’ailleurs). Ils se ravitaillaient donc au puits ou à la citerne des proches voisins quand on leur en octroyait la permission.
Les hommes restaient « au campement » : ils tressaient des vanneries dont beaucoup étaient tournées avec art. Les femmes en assuraient la vente. Certaines d’entre elles étaient fort belles avec leurs jupons bariolés et les yeux de braise cernés de noir (un reste de charbon de bois ayant servi à griller les hérissons, dont ils se régalaient, leur tenant lieu de khôl). Les femmes, disais-je, sillonnaient la campagne presque toujours pieds nus, les bras chargés de paniers dont l’un d’eux contenait diverses fanfreluches : boutons de corozo cousus sur un carton coupé à la demande, des mètres de rubans de dentelles, des épingles de nourrice, des aiguilles à coudre, du fil de différentes grosseurs, du blanc et du noir, parfois aussi des fusettes de fil de couleur. Très peu de choses en fait. Mais ces femmes étaient très diplomates, voire fines psychologues. Elles avaient une sorte d’ascendant (elles le savaient bien les bougresses !) quand elles étalaient leurs articles et vous fixaient dans les yeux. Plusieurs cas pouvaient se présenter :
1er cas : le ou la visitée refusait catégoriquement parce « qu’i avons besoin de rin ». Alors pleuvaient les invectives et les prédictions funestes de toutes sortes de la part de la vendeuse, qui vous maudissait vous et les vôtres jusqu’à la nème génération et ce, tout en crachant par terre.
2ème cas : bon ! on avait besoin de rien c’était sûr mais on n’osait pas éconduire violemment la vendeuse. Bien sûr qu’on n’était pas superstitieux, la main sur le cœur c’était juré. Mais vous savez ce que c’est, on ne sait jamais, au cas où … les mauvais sorts étant jetés avec tellement de persuasion, qu’il faut voir, ne pas se hâter et réfléchir avant d’opposer son veto. Alors on se laissait aller : on achetait quelques boutons et un mètre de dentelle. Dans ce cas la gentille acheteuse s’entendait gratifiée de toutes les bénédictions, d’un avenir sans nuage, d’une santé à toute épreuve, j’en passe et des meilleures, pour peu que la vendeuse en vienne à se saisir de votre main gauche (celle du cœur) et y lise des félicités tout à fait mirifiques. C’était pratiquement le nirvana assuré.
« Les galopins fasiont grand’pou aux drôles bin sûr », mais disons que par leurs anathèmes bien appuyés, ils ébranlaient parfois les esprits les plus cartésiens des grands.
La frontière entre fascination et répulsion est bien ténue et l’on bascule pour un rien de l’une à l’autre, c’est bien connu.
D’une manière sûrement inavouée, leur philosophie de la vie rendait un peu envieux ceux qui trimaient tout leur soûl pour pas grand-chose, disaient-ils.
Est-ce la nostalgie qui, de nos jours, pousse certains vacanciers à se muer en baladins et louent une roulotte pour ce faire ? Admirez celle qui a croisé l’objectif de Jean-Paul Barrot (voir page de couverture). Allez ! Ça fait envie, avouons-le.
La légende dit qu’à la mort du chef de la tribu, on brûlait sa caravane. C’est la raison pour laquelle, dit-on, elles sont si rares de nos jours.
Le stationnement, à Saint-Sauvant, de ceux que l’on appelle à l’heure actuelle « les gens du voyage » a cessé dans les années 1952-1953 : le pasteur Michenot ayant demandé à son Conseil Presbytéral d’intercéder auprès du maire de l’époque.
Le loup-garou fasait grand’pou li étout. Tchi qu’ol est core que tchelle estamèle ? (voir page précédente photomontage Imageur Georges Thaller).
Le loup-garou était naguère un homme avant qu’il ne lui soit arrivé la terrible aventure suivante et qui allait changer sa destinée : oui, un homme tout ordinaire qui par une nuit de pleine lune s’est trouvé à croiser la route d’un lycanthrope (c’est le synonyme de loup-garou), lequel l’a cruellement mordu, et cet homme, les nuits de pleine lune, se transformera lui-même en loup-garou qui mordra cruellement un homme ordinaire, qui mordra, etc, etc …
Beaucoup de personnes autrefois croyaient dur comme fer en l’existence des loups-garous. Bien sûr elles n’en avaient pas vu personnellement, mais elles connaissaient une personne digne de foi qui elle-même, etc, etc …
Vous avez bien, vous-mêmes, entendu l’histoire de l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours ! … Reconnaissons, il est vrai, que certains hommes ont véritablement une gueule de loup et certains loups un faciès d’humain (voir ci-dessous croquis de Charlotte Poinsteau). C’est troublant, non ?
Une bête qui fasait grand’pou étout ol était la bigorne.
La bigorne au fond du puits sévissait 24 heures sur 24, pour peu qu’elle fût sollicitée. La preuve de son existence réelle, c’est que si un père tenant bien solidement son enfant au-dessus de la margelle et d’une voix sépulcrale demandait : « es-tu là bigorne ? ». À cette question la bigorne répondait avec la même voix d’outre-tombe : « es-tu là bigorne, es-tu là bigorne, es-tu là bigorne ? » - trois fois. La troisième était la plus confidentielle comme pour mieux attirer les petits croyait-elle. O fasait grand’pou aux éventuels curieux qui auraient pu se pencher, mais une pareille expérience les en dissuadait à coup sûr.
La bigorne était également présente dans la mare que la route séparait du puits. On se rendra compte sur cette vieille photo, prise par moi-même en 1958 (photo ci-dessous), combien cette bête devait être énorme pour se trouver aux deux endroits en même temps.
Ça forçait le respect … et la trouille donc ?
La vieille : tous les petits enfants la reconnaissaient de loin : elle état le prototype des grands-mères âgées et usées de cette époque, dos cassée, habillée de noir, fichu sur la tête. Elle hantait les chemins creux et herbus d’autrefois, appuyée d’une main sur son bâton et « suitée » de son inséparable bique cornue qui, elle, était ravie de brouter toutes sortes d’herbes aux saveurs délicates et variées. De son autre main elle tenait le bas de son « devantâ » ( tablier ) de manière à faire une grande poche, « la dorne » et quand ça gigotait là-dedans il s’agissait pour sûr d’un insoumis sorti sans le consentement de sa mère. Il traînait par-là et hop ! dans la dorne. En réalité il s’agissait de sa lapine qu’elle venait de marier au mâle de sa voisine. Quand ça ne remuait pas c’est que la Vieille avait « rapaillé », glané, grappillé en vrac des noix, des châtaignes, des champignons, des pissenlits, des durâs pour ses lapins, quelques fusées de maïs pour ses poules le tout selon les saisons et l’abondance. La chèvre était destinée à fournir le lait pour les enfants retenus en otage chez elle.
La pauvre Vieille et celles qui se sont succédé avaient-elles conscience de la trouille enfantine qu’elles suscitaient ? S’il y a un côté positif c’est que ces êtres fabuleux retenaient les enfants de s’aventurer seuls la nuit et même le jour, l’aspect vraiment négatif était parfois désastreux. On a fait sans le savoir (puisque c’était pour leur bien) des générations de mômes tellement peureux de la nuit qu’ils n’arrivaient pas, même grands adolescents, à se raisonner pour se rendre à l’écurie ou gagner cet édicule que le chanteur appelle joliment « la cabane au fond du jardin ».
Les sorciers eux étaient bien réels, connus et reconnus comme tel : c’était « Jhandet la tribale » (pas pressé, toujours en retard sur ses confrères), « Poël Nègre » (parce que très brun), « Rousset le bouétou » (roux et boiteux), « Taite Calète » (parce que chauve complet), « Hérissin Raboulâ » (tout à la fois râblé et mal peigné), « Copoux de Lâchets » (ouvrier agricole bineur, littéralement : coupeur de lombrics).
On les craignait, on les haïssait mais on n’oubliait surtout pas de les saluer très respectueusement. C’est ainsi que tout manquement à ce rituel était suivi d’une punition immédiate en retour : le pneu du vélo éclatait, la machine à battre s’arrêtait et tout redevenait normal selon le bon vouloir du sorcier qui, disait-on, subissait les pires supplices durant ses maléfices. Il était affreusement brûlé par un bûcher ardent invisible et il devait, affirmait-on, descendre dans sa citerne pour ne pas périr. Et même qu’il pouvait y rester tout un après-midi.
Le jour de leur inhumation, il était avéré (?!?!?!) que lors de la descente en terre de leur cercueil se déclenchait une tempête cataclysmique encore jamais vue. Tout redevenait calme brusquement lorsque la terre avait recouvert le défunt.
Quand on croisait un sorcier, il fallait en toute hâte retirer son vêtement et vivement le renfiler … à l’envers pour conjurer, ou bien balancer une poignée de gros sel par-dessus son épaule et toujours porter dans ses poches quelques gousses d’ail. Là, on ne risquait plus rien !
Voilà, chers lecteurs, vous connaissez maintenant l’antidote si d’aventure vous veniez à croiser la route de l’un d’entre eux.
La chasse à la mitarde – Certains jeux (!) étaient particulièrement féroces : c’est ainsi que des chasseurs peu scrupuleux et encore moins charitables invitaient un pauvre naïf à venir avec eux pour chasser la mitarde par une nuit très sombre. La mitarde, vous l’avez compris, était un animal fabuleux imaginaire. La personne crédule était abandonnée égarée dans la campagne et devait se débrouiller toute seule pour rentrer chez elle. Sympa non ? Ne trouvez-vous pas plus que bizarre de s’amuser de choses pareilles ?
La chasse-galerit était une chasse fantastique menée la nuit par des cavaliers galopant dans les airs – était aussi nommée « chasse-briquète » dans la Vienne. Disons qu’ol était dans le piancher (grenier) daus ralirins (loirs) ou daus rats de lattes (gros rats) qui fasiont le charivari.
Les spectres, les dames blanches et les errants de la nuit – Les voyageurs qui les rencontraient (!!) la nuit, à la lumière des lanternes de leurs voitures à cheval ou des phares de leurs voitures automobiles, disent que :
1°) ces halos lumineux évanescents se dissipent au fur et à mesure que leur voiture s’approche,
2°) ou bien que les dames blanches et les errants de la nuit fassent du stop : les automobilistes s’arrêtent et les font monter. Ces passagers, disent-ils, ne parlent que pour dire de les emmener « chez eux » et le « chez eux » c’est le cimetière.
Ce sont paraît-il des êtres qui, pour l’éternité, sont entre la vie et la mort : des zombies en quelque sorte.
Il est à préciser que ces « phénomènes » se produisent dans des régions bien déterminées où la superstition est étroitement mêlée à une certaine forme de religiosité très loin de la foi de certains croyants.
La sorcière maléfique – Et que dire de la mésaventure subie par ce malheureux jeune marié à qui le sorcier (e) malfaisant (e) avait promis de nouer l’aiguillette le soir de ses noces et qui a tenu sa promesse.
L’aiguillette est un petit cordon avec à chaque extrémité un petit étui de métal comme à certains lacets (aguiètes en patois), pour chaussures ou vêtements (polo, chemisier). Autrefois les pantalons (hauts-de-chausses par le passé) se fermaient et étaient retenus à la taille par une aiguillette. Imaginez le résultat désastreux que cela pouvait générer quand l’aiguillette ne pouvait plus se dénouer lors de la nuit de noces !
« Aiguillette nouée, mariage non consommé, époux dépités
Hou !… les vilains sorciers ! »
Les fantômes, zeux étout fasiont grand’pou – Ils sévissaient surtout bien sûr la nuit dans des demeures habitées ou non (maisons ou châteaux). Ces fantômes étaient des personnes bien vivantes recouvertes de draps blancs et qui étaient très désireuses d’acquérir ces bâtisses (et ce par n’importe quel moyen). Les propriétaires minés par la peur déménageaient et vendaient, ne supportant plus ces lieux dits maléfiques, ces fameuses maisons hantées.
La notion de pendu était très ambiguë, macabre, sinistre et pour tout dire de parfait mauvais goût lorsque certains illuminés tentaient de récupérer un morceau de corde pour l’enfouir dans sa poche parce que ça portait bonheur !!! …
Mais comme on n’était pas à un paradoxe près, on affirmait a contrario que vivre dans une maison où un pauvre désespéré s’était jadis pendu provoquait des malheurs successifs de toutes sortes. Parfois certaines de ces maisons restaient inoccupées pendant de nombreuses années.
Bien évidemment il y avait autrefois dans nos campagnes beaucoup d’autres raisons de « frissonner », outre le froid.
Par exemple, comme dans notre région il y avait des tombes au fond de chaque jardin, il y avait, les nuits d’été, des feux-follets qui émanaient de ces cimetières. Les flammèches semblaient poursuivre le passant qui prenait la poudre d’escampette.
Les temps ont changé. Les hommes et les femmes aussi. On ne s’amuse plus à se faire peur, du moins pour ce qui effrayait autrefois. La réalité de la vie amène bien d’autres sujets de craintes et d’angoisses. Il reste que les légendes ne s’éteignent pas comme ça … et que de toute façon en se les remémorant on aime encore à se faire peur ou à croire qu’on a peur.
Chers lecteurs, chères lectrices, i vous souhaite bon courage : tâchez moyen de jamais croiser daus maufasants qui vous balanceriont daus sorts. Et si o vous arrivait, i va vous douner la facin la meilleure, ol est de pas y crère !